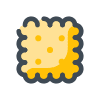MICROPOLITIQUES DES GROUPES
POUR UNE ÉCOLOGIE DES PRATIQUES COLLECTIVES
David Vercauteren
 FICHE DE LECTURE
FICHE DE LECTURE
Contexte
Le livre « Micropolitiques des groupes : pour une écologie des pratiques collectives » publié en 2007 aux éditions HB a été écrit par David Vercauteren, avec la collaboration de Thierry Müller et Olivier Crabbé. Il fait suite aux réflexions et leçons tirées suite à plusieurs années d’engagement militant, dans différents collectifs. L’ouvrage est aussi un appel à créer un espace de réflexion sur les questions micropolitiques, c’est-à-dire sur les dynamiques de pouvoir, les pratiques, et formes d’organisation collective qui émergent dans les groupes et collectifs.
On y perçoit néanmoins une certaine tension entre la volonté de restituer et de transmettre des réflexions sur les actions et les pratiques, et la nécessité de les mettre par écrit avec un regard critique : les pratiques peuvent-elles s’écrire ? En le faisant, les auteurs ne risquent-ils pas de perpétuer une division entre théorie et praxis ? En ce sens, le livre devrait surtout être employé pour réfléchir aux pratiques existantes, en fonction des besoins des groupes, et il devrait être perçu comme une incitation (et une invitation !) à se transmettre les connaissances au sein et entre les groupes et collectifs dont nous faisons partie – L’usage de l’ouvrage a d’ailleurs été pensé en amont puisque deux circuits sont proposés pour parcourir les différentes entrées classées dans l’ordre alphabétique, l’un pour les groupes en formation, l’autre pour les groupes en crise.

Vous aimez nos contenus ? Pourquoi ne pas vous y abonner ?
Trajectoire de l’auteur
Micropolitiques des groupes se concentre sur des concepts et pratiques propres aux micropolitiques, mais il est impossible d’en parler correctement sans situer le point de vue et notamment la trajectoire politique de(s) auteur(s). Les réflexions des textes sont en effet imprégnées des expériences vécues par ces derniers.
David Vercauteren partage sa première expérience politique au sein des Verts pour une gauche alternative (VeGA), un mouvement politique belge créé en 1986. En décrivant les raisons de son départ de ce parti, il offre une réflexion critique sur la manière dont la politique était exercée au sein de cette organisation. Celle-ci repose sur une croyance dans la stratégie de « prise du pouvoir » – que cela soit au niveau parlementaire (obtenir une majorité), ou au niveau de projets plus révolutionnaires. Le bémol, c’est que le but espéré d’une accession au pouvoir de certaines idées et projets semble vouloir justifier et accepter toutes les pratiques collectives problématiques qui pourraient en découler. Or, ces pratiques collectives, qui laissent déjà entrevoir certaines facettes de ce futur éventuel, devraient pouvoir être questionnées. C’est aussi une vision du militantisme particulière que l’auteur critique, celle où le militant ne jure que par le tout-politique et ne laisse pas échapper ses émotions, ses affects – celle d’une déconnexion du corps en somme, où le « militant professionnel » doit correspondre à un certain idéal déconnecté de la réalité. S’y ajoutent enfin une critique sur le cloisonnement des différents temps du quotidien militant : on ne maitrise pas son temps et on milite le soir après le travail, dans un temps soigneusement découplé des loisirs et autres « activités futiles et agréables ».
Ces critiques semblent aujourd’hui plus largement partagées car les pratiques militantes évoluent elles aussi bien que certaines personnes continuent de pratiquer la politique de manière traditionnelle, en particulier dans le contexte de la politique partisane et électorale. Par exemple, cette figure du « militant professionnel », qui semble se rapprocher d’une certaine forme de masculinité blanche, est de plus en plus contestée, laissant place à d’autres formes d’engagement militant. Par ailleurs l’expansion du secteur associatif suggère une volonté croissante de coupler militantisme et travail salarial. Enfin, en dernier exemple, on pourrait citer le concept de joie militante qui semble gagner en importance dans de nombreux groupes et dans les façons de concevoir l’action politique tout comme l’organisation collective des groupes : il s’agit, en partie, d’essayer de rendre le militantisme agréable, et donc durable sur le long-terme.
On peut suivre ces évolutions générales des méthodes militantes à travers le parcours de l’auteur. En 1997, à Bruxelles, il se lance avec d’autres dans une initiative visant à réapproprier des espaces urbains pour les transformer en logements et en lieux autonomes dédiés aux activités culturelles, politiques, de solidarité, de travail coopératif, etc., au sein du Collectif Sans Nom. Celui-ci permet l’ouverture d’un centre social l’année suivante. Cette démarche avait un objectif majeur : « s’approprier ses temps et ses espaces de vies ». Cette façon de militer à travers l’occupation et la réappropriation d’espaces s’apparente à celles des squats et des Zones à Défendre (ZAD) par exemple ; elle est le produit direct d’une « évolution des lieux de conflictualité » où l’usine n’est plus le centre des luttes sociales et politiques, notamment syndicales. Ils se manifestent plus essentiellement dans l’usine, mais de façon diffuse dans la société, dans nos déplacements ou au niveau du corps (sexisme, racisme, validisme…) et des affects. Se réapproprier des espaces pour des luttes transversales, c’est aussi le produit d’une volonté d’ancrage physique de ces différentes luttes, une volonté de faire de ces lieux un/des « carrefour(s) ».
Cette expérience est plutôt courte puisqu’elle ne dure qu’un an et demi après s’être heurtée à plusieurs limites. D’abord, celle de l’émergence de normativités alternatives : En tentant de contourner certaines normes, le groupe a involontairement créé de nouvelles normes que l’auteur qualifie de « prise d’otage individuelle et collective ». Ensuite, il y avait la contrainte inhérente au fait même de dépendre d’un espace à occuper, investir, animer, faire vivre. Seules les personnes qui y sont suffisamment impliquées au quotidien peuvent se saisir pleinement de l’expérience ; en sont facilement – et implicitement – exclues les personnes aux disponibilités limitées. Avoir des contraintes personnelles, professionnelles, ou familiales autres les écartent des réseaux informels qui se constituent dans le lieu et sa gestion, et donc de là où le pouvoir s’exerce de fait. Enfin, l’afflux de sollicitations et la « tyrannie de l’urgence » entraînent le groupe dans un fonctionnement qui manque de recul. Les membres du collectif sont par ailleurs exposés à la peur de la répression judiciaire et policière. Toutes ces raisons mènent à leur auto-dissolution et à la naissance en juillet 1999 du Collectif Sans Ticket (CST) qui se concentre sur un objectif plus précis : la gratuité et la lutte contre les phénomènes de marchandisation et de privatisation.
En analysant a posteriori le fonctionnement collectif au sein du CST, l’auteur en extrait une problématique, qui semble accompagner toute la rédaction de l’ouvrage : les processus de groupe, c’est-à-dire les dynamiques de pouvoir, les pratiques et formes d’organisation collective – en somme, la micropolitique, ne sont pas réfléchis ni dessinés collectivement.
« Il ne nous viendrait pas à l’esprit de penser la politique et les rapports sociaux d’un point de vue naturaliste. On aurait même tendance à qualifier de réactionnaire cette pensée qui conçoit la société à partir d’un ordre naturel des choses. Mais bizarrement une partie de nos pratiques collectives s’organisent implicitement à partir de postulats issus de ces pensées. Cela devient embêtant de le dire mais croire qu’il suffit d’un peu de bonne volonté ou d’être naturel pour faire un groupe, voire un monde plus juste, c’est comme dire à un ouvrier d’aller pisser devant la porte de son patron pour que cesse l’exploitation. »
Pour réfléchir à tout ça, il est décidé de faire un « pas de côté » au cours des 6 derniers mois précédant l’auto-dissolution du CST en 2003 dans le but d’évaluer de manière réfléxive les pratiques de groupe en cours. Cette période a donné naissance à des rencontres, des recherches, des écrits… et finalement, à ce livre-même. Ce qui rend l’ouvrage d’autant plus précieux, outre la volonté de transmission de réflexions et d’outils, c’est le fait que toute la théorie présentée qu’on y retrouve, façonnée en mobilisant des ressources philosophiques diverses (Spinoza, Nietzsche, Foucault, Deleuze …) repose d’abord sur des exemples concrets et des expériences passées qui ont été menées collectivement ! Il invite ainsi à nous questionner sur nos propres méthodes de travail en groupe. Cependant, on peut regretter que la plupart des réflexions présentées ne soient pas directement applicables dans la pratique.
Synthèse
Le livre propose une exploration de la micropolitique. Avant d’aller plus loin, il est essentiel de clarifier ce que l’on entend par « micropolitique » : elle est ici définie comme l’ensemble des dynamiques de pouvoir, d’influence, et de prises de décision qui ont cours dans des contextes de groupe (y compris collectifs et associations). On pourrait aussi parler d’organisation collective ou de la question du faire au sein des groupes, même si cela ne se réduit pas à la seule micropolitique. La micropolitique englobe cependant des phénomènes tels que la formation d’alliances (ce qui implique la création de sous-groupes), l’émergence de conflits, ou encore les processus de négociation, de distribution, et d’exercice du pouvoir – pouvoir fonctionnant souvent dans les groupes selon une structure informelle, qui ne dit pas son nom, qui peut dépendre de sous-groupes et des relations interpersonnelles Il peut également être en décalage complet avec la structure formelle affichée publiquement (il en va ainsi des groupes qui se disent horizontaux sans être structurés – là-dessus on se référera au texte de Jo Freeman, la tyrannie de l’horizontalité ou à l’entrée « Assembler » du livre). Les ramifications de la micropolitique sont nombreuses : il s’agit aussi de se questionner sur la façon dont nous organisons nos réunions, sur nos comportements en groupe, nos manières de nous organiser en interne, et bien d’autres questions.
L’ouvrage part d’un constat : les questions micropolitiques sont trop souvent délaissées au profit des questions relatives aux actions et événements, aux orientations politiques et stratégiques du groupe, etc., c’est-à-dire au profit de la macropolitique. De plus, il met en lumière le manque de transmission de savoir-faire pratique concernant le fonctionnement interne des groupes et les relations entre leurs membres et il déplore le manque d’une « culture des précédents » au sein de nos groupes. Le texte se présente comme un manifeste qui appelle à la création d’une culture des précédents plus forte, non seulement à l’intérieur de chaque groupe, mais aussi entre les différents groupes. Il encourage également à adopter un « art du bricolage dans nos manières de faire ». Cette culture des précédents engloberait à la fois la transmission des pratiques effectives des groupes, et leurs difficultés, échecs et succès, favorisant ainsi les échanges et les expérimentations, le tout accompagné d’une réflexion critique, un « pas de côté ». En somme, elle permettrait de se partager et de cultiver des savoirs précieux pour la vie des groupes et collectifs, tout en aidant à lutter contre les phénomènes qui peuvent les fragiliser, voire les mener à leur déclin, tels que les dynamiques d’exclusion, les logiques basées sur les affinités, ou le manque de remise en question collective, entre autres..
David Vercauteren explique l’absence de transmission des pratiques au sein des collectifs, et par conséquent le manque d’une culture des précédents, par la dépossession des savoirs et techniques engendrée par le capitalisme. Il souligne que cette perte est en partie produite par les groupes-mêmes qui devraient s’opposer au capitalisme – notamment par le mouvement ouvrier..Cette difficulté découle de la complexité à penser l’articulation entre ce que le groupe accomplit ou produit et la manière dont il fonctionne.
Comme mentionné précédemment, le livre propose deux parcours pour explorer ses diverses sections. : un premier parcours pour les groupes qui se forment, l’autre pour les groupes en crise.
Le premier parcours explore les rôles que nous choisissons ou pouvons choisir au sein de nos groupes, la manière dont nous nous rassemblons, comment nous prenons des décisions, comment nous organisons et conduisons nos réunions. Il aborde également les « artifices » – des procédés et pratiques inventés qui contraignent le groupe à changer certaines habitudes tout en s’ouvrant à de nouvelles potentialités –, la construction de puissance au sein d’un groupe, et la façon dont on (dé-)programme nos actions en fonction des objectifs que nous définissons.
Dans le second, on se focalise sur la notion d’événement – c’est-à-dire la crise ou le moment qui déclenche la « fêlure ». Cela est illustré par l’exemple du CST, où l’on examine la succession de signes qui conduisent à la rupture, son auto-dissolution –, sur les façons de s’évaluer collectivement afin de permettre l’expérimentation, sur les notions « d’artifices », ainsi que sur la réflexion autour des dynamiques de pouvoir et des rapports de force au sein d’un collectif. Cette réflexion va au-delà de simples « conflits de pouvoir ». Elle s’intéresse également au processus de scission, aux pièges qu’il peut entraîner, à l’importance de la communication, en particulier aux sous-jacents rapports de force présents dans notre langage et nos dialogues. L’auto-dissolution est un autre sujet abordé. Enfin, une réflexion , sur l’intégration du « souci de soi » dans nos groupes et nos actions politiques est présentée, avec une attention spécifique sur le lien entre politique et spiritualité. Sans oublier, une exploration renouvelée des rôles au sein des groupes.
On se propose d’explorer une petite partie des entrées conseillées pour les deux parcours esquissés – sans que cela soit exhaustif pour autant : les artifices, évaluer, programmer, puissance, rôles, et scission.
Cet article de l'Université Populaire des Luttes
Pour approfondir
Artifices
Ce que Vercauteren appelle les artifices, ce sont les outils – à mi-chemin entre outil technique, pratique, et théorique – qui permettent de faire face aux difficultés dans les groupes, c’est « l’invention de procédés et d’usages qui contraignent le groupe à la fois à modifier certaines habitudes et à s’ouvrir à de nouvelles potentialités. ». En somme, les artifices sont ce qui permet de faire avancer un collectif en aidant à constituer une culture de groupe, en cultivant des (nouvelles) manières de faire, ou en permettant des expérimentations. Mais plusieurs risques sont distingués par l’auteur : le formalisme, le moralisme, et le méthodisme.
Ces risques sont caractérisés par le fait d’enfermer les artifices inventés dans des façons de faire devant être suivies scrupuleusement ou dans des routines qu’on ne questionnerait plus. Or, il est important de se souvenir du pourquoi de l’invention de ces-dits artifices, de permettre leur adaptation en fonction des besoins du groupe. Enfin, il importe également de ne pas s’enfermer dans des questions de pure méthode. Les artifices sont mis en place pour expérimenter, pas pour qu’ils deviennent un outil de rationalisation excessive de nos pratiques de groupe auquel il faudrait toujours se référer et se soumettre car cela a été décidé ainsi :
« Tout ce qui échappe à ce mode (les affects, les idées qui sortent du cadre…) doit soit être réintégré dans la logique, soit être expulsé. L’artifice ici se conjugue avec une violence « douce », démocratiquement consentie. Les managers et autres responsables des ressources humaines ne s’en privent pas, ainsi d’ailleurs qu’une partie du monde associatif. »
Evaluer
L’évaluation est nécessaire car elle offre une opportunité d’opérer un retour réflexif sur nos expérimentations, nos trajectoires de groupe. Toutefois, il est essentiel de se prémunir contre certains écueils, notamment celui lié à une conception néolibérale de l’évaluation où le fait d’évaluer est assimilé à un contrôle strict et à un encadrement jusqu’au niveau individuel. Dans l’ouvrage, la distinction de Jacques Ardoino entre « évaluation contrôle » et « évaluation signe » est reprise. L’évaluation contrôle consiste à examiner a posteriori l’écart entre les résultats obtenus et les projections faites au préalable, tandis que l’évaluation signe implique de se questionner sur les trajectoires suivies au cours du processus. L’objectif de l’évaluation signe n’est donc pas de vérifier la conformité aux normes ou à un modèle préétabli, mais de créer des opportunités pour de nouvelles orientations en cours de route, en évitant toute rigidité. C’est ce type d’évaluation qui semble être privilégié dans le texte,avec l’exemple de l’artifice du « pas de côté » qui permet de prendre du recul sur les projets menés par un groupe et les directions prises jusque-là, mais aussi d’expérimenter.
« Il s’agit à travers ce type d’évaluation d’apprendre à penser collectivement, aussi bien sur les processus qui fabriquent le groupe, sur les rapports aux actions engagées que sur les manières de les transformer. Devenir, en somme, capable de créer du savoir qui compte et importe pour les membres du groupe et peut-être, ensuite, de le transmettre, de l’échanger avec d’autres groupes actifs. »
Programmer
De façon générale, le livre ne se fait pas l’apologie des méthodes excessivement rigides. Il en va de même pour les questions d’élaboration et de réalisation du programme d’un groupe : au lieu de se concentrer uniquement sur l’atteinte des objectifs, le texte met l’accent sur la manière dont on peut naviguer à travers les différentes étapes du parcours. Il souligne l’importance de prendre en compte les variations possibles lors de la déclinaison opérationnelle d’un projet, et d’adopter une approche de « vagabondage en ligne droite ». Même si cela signifie ne pas toujours suivre le programme initial et signifie plutôt : remettre en question ce programme, être ouvert·es à d’autres perspectives et le réadapter en tenant compte des détours possibles et des développements, tout en gardant à l’esprit les intentions à l’origine du programme initial. En résumé, il est essentiel de reconnaître que tout ne peut pas être planifié à l’avance ni suivi de manière linéaire, et qu’il est nécessaire de rester ouvert·es aux ajustements progressifs. Il est ici préconisé d’anticiper ces changements de programme, par exemple en inventant des rôles comme « l’aveugle » :
« celui qui indique que le chemin n’est plus trop clair, qu’il faudrait nous arrêter un peu, pour voir où chacun d’entre nous se trouve et si nous ne sommes pas en train de nous perdre. »
Ou « le cartographe » :
« celui qui se souvient plus précisément des monts et des vallées qui ont été traversés et des raisons invoquées lors de chaque bifurcation. »
Ou encore « l’ancêtre » : celui qui rappelle « quels étaient nos mobiles de départ ».
Puissance
La « puissance » telle qu’elle est décrite dans le livre se réfère à la capacité perçue par les membres d’un groupe à agir ensemble. Cette puissance émerge des interactions, rencontres, et des dynamiques de création et de destruction au sein du groupe. Elle varie ainsi en fonction des personnes qui le composent, ainsi que des émotions positives ou négatives (dans le texte, les « passions joyeuses » et les « passions tristes ») qui le traversent L’intérêt pour un collectif étant bien évidemment de construire de la puissance collective d’agir pour pouvoir mener à bien ses projets.
Vercauteren souligne que nous ne sommes pas toujours capables d’identifier correctement ce qui génère de la puissance ou non. Nous ressentons simplement les affects. En d’autres termes, nous percevons si, par exemple, notre participation à un groupe nous satisfait ou non, que ce soit en raison des personnes que nous y rencontrons, « des idées, des atmosphères, des odeurs » … Si les rencontres sont positives, les affects de joie dépassent ceux de tristesse, et le groupe « prend » ; dans le cas inverse, le groupe ne prend pas, il n’a pas d’impact positif, mais il est toujours possible de réorganiser les éléments pour tenter de susciter de la joie. L’important reste de ne pas s’enliser dans les passions tristes, les sentiments coupables, désespérés, voire haineux, ou de persister sans questionnements. Ces « passions tristes » peuvent également se manifester physiquement et occuper notre espace mental, car nous dépensons de l’énergie à essayer de comprendre ce qui ne va pas. De plus, cela ne conduit qu’à l’impuissance, alors que nous sommes déjà confrontés à ces émotions au quotidien sur le plan politique
Il est donc nécessaire d’essayer d’identifier, par le biais de l’expérience, les facteurs externes qui influencent nos émotions et déterminent notre capacité à agir, afin de chercher à cultiver la joie. Par-delà ces émotions positives, il s’agit de développer des « notions communes ». L’auteur entend par-là la capacité à tirer des enseignements collectifs de ce qui génère de la joie dans un groupe, et à mobiliser ces enseignements lorsque les émotions négatives prennent le dessus. Tout cela se fait grâce à des expérimentations visant à créer de « nouveaux modes d’existence » et à tâtonner pour trouver des solutions.
Rôles
La création de rôles au sein de nos groupes est un artifice qui vise à répondre à la nécessité de réfléchir à la dynamique collective, de concevoir le groupe comme « système » à entretenir pour pouvoir créer une capacité d’action collective efficace. Cela sert notamment à prévenir l’émergence de ce que l’auteur appelle la « haine de la communauté », qui se développe parfois dans les interactions collectives en raison de la mise en place de rapports hiérarchiques et verticaux, de l’apparition de chef·fes, ou encore de la psychologisation et du réflexe néolibéral qui vise à tout rapporter – autant les problèmes et difficultés que les réussites – aux seuls individus.
Il s’agit donc aussi de pouvoir se donner la capacité de questionner nos manières de faire collectives pour éviter le déchirement de nos groupes. Pour cela, il importe d’éviter de se laisser dépasser collectivement par des façons de faire automatisées qui peuvent mener à exiger de nous plus que ce que nous sommes en capacité de donner, voire de nous faire tendre vers un type d’engagement militant sacrificiel, par exemple, dans les projets du groupe. Le cas des départs du groupe est donné en exemple : au lieu de chercher à comprendre ce qui aurait pu éviter cela et de se questionner sur la façon de fonctionner collectivement, on peut avoir tendance à en faire une affaire personnelle, psychologique.
L’objectif principal de ces rôles est de nous permettre d’attribuer la responsabilité de surveiller les différentes facettes de la dynamique de groupe à plusieurs personnes. Souvent, nous adoptons spontanément des rôles, mais il est important de prendre conscience de cette répartition informelle des rôles et d’avoir une perspective critique sur les rôles que nous pouvons jouer dans un collectif. De plus, il est essentiel de ne pas figer ces rôles, c’est-à-dire de les redistribuer, d’en incarner d’autres, de les faire jouer différemment, voire également d’en inventer d’autres encore qui répondent aux besoins de la vie du groupe.
Deux exemples-types de rôles pouvant être déjà existants, non conscientisés, mais potentiellement préjudiciables à la vie du groupe sont identifiés dans le texte : la « princesse » et la « star ». Sont également mentionnés « le timide », ou « le râleur »
La princesse est « tellement sensible que le groupe n’est jamais assez doux à ses yeux, [elle] se sent obligée de faire remarquer à tout bout de champ de petites tensions ou des nuances mineures de conflits, qui s’exprime souvent avec une grande anxiété. », elle « laisse souvent tomber les groupes si elle ne les dirige pas. ». Il est suggéré que le groupe pointe son « apport ‘thérapeutique’, son côté ‘médium’ », qu’il se pose la question, avec sa bonne volonté : « avec qui la princesse est-elle en compétition et à propos de quoi ? ».
L’autre exemple est celui de la « star », la personne « qui croit toujours que les réunions n’ont jamais vraiment commencé tant qu’[elle] n’est pas arrivée, qui a réponse et argument sur tout et avec brio, qui prend toujours la parole et interrompt tout le monde ». Pour rendre son rôle bénéfique à la vie de groupe, « il peut être utile de se demander de quelle fonction [cette personne] peut s’emparer, qui l’aide à mettre ses talents connus ou d’autres insoupçonnés au service de l’énergie du groupe par exemple ou d’une distribution attentive et équilibrée de la parole entre [toustes] ? »
Starhawk distingue également plusieurs rôles que l’on peut délibérément incarner et distribuer en fonction des besoins que l’on souhaite prioriser pour entretenir la vie du groupe : les « serpents » se chargent de détecter les conflits émergents et les non-dits, puis de les amener à la lumière publique pour une gestion collective. Les « grâces » se préoccupent de l’enthousiasme du groupe et de sa capacité à accueillir, tandis que les « dragons » mettent en évidence les limites du groupe (en ce qui concerne les ressources et l’énergie…). Les araignées servent de point de contact entre plusieurs personnes ou avec l’extérieur, et veillent à ne pas monopoliser les informations et la communication tout en contribuant au tissage d’une toile qui ne dépend pas exclusivement d’elles. Enfin, les « corbeaux » se penchent sur les questions stratégiques et les perspectives à long terme du groupe.. Nous vous encourageons à explorer ces différents rôles dans le manuel Comment s’organiser ? de Starhawk, publié aux éditions Cambourakis.
D’autres fonctions formelles essentielles peuvent également être assignées, en particulier pour les réunions. Parmi celles-ci, on retrouve le ou la facilitateur·ice, le ou la secrétaire, le ou la gardien·ne de l’ambiance, le ou la médiateur·ice, le ou la coordinateur·ice, etc. Il peut être bénéfique de se réserver un moment de réflexion en fin de réunion pour se questionner sur la manière dont les rôles ont été assumés et quels ont été leurs impacts sur la réunion.
L’existence de rôles permet de répondre aux besoins du groupe, permet à chacun·e d’apporter une contribution, ou encore de prendre du recul vis-à-vis de nos comportements habituels en groupe. Il est crucial d’éviter la monopolisation des rôles, en particulier en dehors de situations d’urgence, et d’essayer d’attribuer un même rôle plusieurs fois d’affilée à une personne qui ne s’y sent pas à l’aise afin de lui permettre de s’adapter progressivement.
Le texte suggère également de se questionner sur les rôles implicites que nous pourrions avoir, d’engager des discussions sur les peurs et les compétences de chacun·e, ainsi que sur les rôles explicites (à éventuellement réinventer !) qui peuvent être instaurés pour répondre aux besoins du groupe.
Scission
Dans l’entrée « scission », il est question des ruptures qui peuvent se produire au sein d’un groupe et de la violence que que ce processus peut engendrer, que ce soit du point de vue des passions tristes : « haine, rancœur, culpabilité » ou du point de vue des actes : « dénonciations, menaces… ». Cela peut notamment résulter de la formalisation de camps opposés (et d’une injonction à en rejoindre un) et de la création d’ennemis internes.
Il est indiscutable que tous les groupes sont susceptibles de connaître de telles situations. Cependant, la question posée est de comprendre ce qui rend possible ce processus de scission, et de savoir si les traits annonciateurs qui permettraient de prévenir une telle situation lorsque l’on commence à s’y diriger sont connus, afin de les prévenir.
Le texte ne propose pas directement de solution pour éviter cela, mais il met en lumière des exemples de signaux qui se manifestent dans la vie d’un groupe et qui sont des indicateurs précoces ou partie intégrante du début d’un processus de scission. Il rappelle également que l’objectif n’est en aucun cas d’identifier des personnes ou des sous-groupes individuellement problématiques, mais plutôt de reconnaître les comportements et les modes de fonctionnement collectif inappropriés. Il encourage à s’appuyer sur une « culture des précédents » (bien qu’elle doive être transmise) pour nourrir des discussions collectives sur les processus et les changements à mettre en œuvre afin d’éviter la désintégration du groupe.
Les exemples de signes mentionnés dans le texte sont les suivants :
– l’idéologisation, lorsque des camps se forment autour de la conviction que chacun détient la seule vérité, parfois en se référant à l’histoire du groupe. L’idéologisation éclipse les questions relatives au fonctionnement collectif et aux modes de vie en groupe, notamment en ce qui concerne le pouvoir, les relations et les affinités…
– la psychologisation, lorsque l’on attribue des positions de façon presque essentialistes à certaines personnes que l’on identifie comme responsables de problèmes ou difficultés passées. Elle engendre des processus de catégorisation, la création de camps binaires, et des généralisations sur le comportement ou sur la façon d’être d’une ou d’un groupe de personnes. « Dans un tel cas de figure, plus besoin de parler, on sait d’avance ce qui va être dit et interprété (…) et quand bien même on écouterait, c’est pour mieux pouvoir dénoncer par la suite ».
– les propagations de rumeurs, dont le but est de stigmatiser, d’alimenter la haine et d’aller chercher du soutien/des alliances auprès de personnes du groupe ou de personnes extérieures, en les incitant à prendre position. Les discussions interpersonnelles privées qui en résultent ont tendance à créer un sentiment d’impuissance et à diviser le groupe en plusieurs figures-types : (éventuellement questionnables) : la personne indignée (qui va prendre le parti de la personne qui propage les rumeurs, dont elle estime que les rumeurs sont fondées), la personne compassionnelle (qui prend « parti pour la douleur qui apparaît comme la plus légitime » pour « partager la souffrance avec la victime du conflit » ou avec la personne perçue comme victime), les proches otages du conflit (qui prennent position par fidélité, parfois par défaut, et qui sont donc tout autant acteur·ices du conflit), les personnes qui refusent de prendre parti et de propager les rumeurs, etc. Quant aux dénonciations publiques pour « un vol, une parole, une violence physique », l’auteur questionne leur utilité et enjoint à plutôt essayer de comprendre ce qui a pu se passer pour se demander :
« comment se fait-il que cet « acte » soit devenu possible ? Dans quelle histoire s’inscrit-il, dans quel contexte, dans quels types de relations, de dispositifs ? Quels sont les rapports de forces qui sous-tendent ces relations et de quelles natures sont-ils ? »
Ces questionnements semblent se rapprocher de questionnements propres à la justice transformatrice – des pratiques non punitives qui nécessitent une prise en charge collective par le groupe, qui visent à responsabiliser les personnes ayant commis des violences, et se centrent sur les besoins des victimes.
L'Université Populaire des Luttes
Traduire, rechercher, mettre en page et faire vivre notre communauté de bénévoles permet de garder en mémoire les récits de luttes, sources inépuisables d’espoirs et d’inspirations tactiques et stratégiques.
Dans un système politique prédateur dont l’un des objectifs est de nous priver de nos repères militants historiques, les moyens de financer ce travail de mémoire sont rares.
Pour nous aider à garder cette université populaire des luttes accessible gratuitement et contribuer à renforcer nos luttes et nos solidarités, faites un don !
VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE
ET VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN ?
On a bien réfléchi et on vous propose de lire celui-ci, qui est très complémentaire.

COMMUNITY ORGANIZING : POURQUOI IL FAUT OUBLIER SAUL ALINSKY
Saul Alinsky, c’était intéressant. Mais nous, on est passés à autre chose.

COMMUNITY ORGANIZING : POURQUOI IL FAUT OUBLIER SAUL ALINSKY
Saul Alinsky, c’était intéressant. Mais nous, on est passés à autre chose.