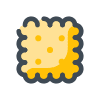Fernand Pelloutier
et les origines du syndicalisme d’action directe
Jacques Julliard
 FICHE DE LECTURE
FICHE DE LECTURE
Par Chloé Rousset | Mai 2021
Contexte
Qu’est-ce que sont les « Bourses du travail » et quel rôle stratégique jouèrent-elles dans le mouvement ouvrier ? Comment s’est développé en France le mythe de la grève générale ? Qu’est-ce que le « syndicalisme d’action directe » ou « syndicalisme révolutionnaire » ? Dans cet ouvrage paru en 1971, Jacques Julliard analyse ces questions par le prisme de la vie et du travail du syndicaliste anarchiste français Fernand Pelloutier. Julliard est lui-même historien, essayiste, journaliste et responsable syndical à la CFDT. Influencé par le travail et l’éthique forte de Pelloutier, ce livre doit selon lui servir à mieux comprendre l’essor du syndicalisme en France et notamment le rôle stratégique et trop peu connu des Bourses du travail, lieu de convergence des luttes et d’éducation populaire.
Synthèse
Ce livre nous plonge dans la France de la fin du XIXe : le pays est alors faiblement industrialisé et est marqué par une grande instabilité de la main-d’œuvre et l’absence de sécurité sociale. Les lois Waldeck-Rousseau de 1884 donnent un cadre légal à l’action syndicale et permettent l’essor des premières Bourses du travail et de confédérations syndicales. Dans ce livre, Jacques Julliard cherche à comprendre le travail de Fernand Pelloutier (1867-1901), qui devient en 1895 secrétaire de la Fédération des Bourses du travail. Cette figure anarchiste de l’ombre, défendant une éthique ouvrière forte, joua un rôle fondamental dans la formation du syndicalisme en France et reste aujourd’hui une source d’inspiration. Pour Pelloutier, le syndicalisme doit préparer la révolution, à savoir la grève générale. D’un point de vue stratégique, cela implique de développer activement les Bourses du travail, c’est-à-dire des organisations anti-autoritaire et d’action directe, qui visent l’émancipation de la classe ouvrière. Un livre passionnant d’un point vu d’organisateur.ice !

Vous aimez nos contenus ? Pourquoi ne pas vous y abonner ?
Les idées à retenir

L’organisation syndicale peut avoir pour triple buts : l’auto-organisation des travailleur·euse·s, la lutte quotidienne en vue d’obtenir plus de droits et le projet politique de transformer en profondeur la société. Ces objectifs s’entremêlent de manière plus ou moins évidente selon les pays et les époques. Pelloutier défend un syndicalisme d’action-directe, partant du principe que la classe ouvrière doit créer ses propres conditions de lutte et ses propres moyens d’action pour s’émanciper.

Le syndicalisme d’action directe se distingue du syndicalisme réformiste par sa défense de l’auto-organisation et de l’auto-émancipation de la classe ouvrière, en vue de préparer la révolution. Là où le syndicalisme réformiste cherche à négocier avec le patronat, le syndicalisme d’action directe cherche à préparer la révolution.

Fernand Pelloutier rejetait les structures qui centralisent trop de pouvoir, car celles-ci prennent le risque de devenir trop bureaucratiques, autoritaires et sclérosées.

Fernand Pelloutier a joué un rôle fondamental dans la structuration du mouvement syndical français, en participant à la théorisation de grève générale et à l’essor des Bourses de Travail.

La grève générale est une idée ancienne, qui revêt de multiples formes. Pour le syndicalisme d’action directe, il s’agit d’une grève de masse stratégique visant la désorganisation et l’expropriation des moyens de production et de circulation, en vue de construire une société basée sur des association de producteur·ice·s et des services de mutualité.

Les Bourses du travail sont des espaces regroupant plusieurs syndicats de métiers sur une zone géographique, et sont des lieux de convergence des luttes, d’éducation populaire et de service de mutualité. Elles ont pour but de préparer à la grève générale.

Après la mort de Pelloutier, le mouvement des Bourses du travail et la doctrine de la grève générale ont continué à jouer un rôle central dans le syndicalisme français.

Pour approfondir
Pelloutier, organisateur des Bourses du travail
Fernand Pelloutier est né en 1867 à Paris, d’une famille modeste. Il décède de la tubercule en 1901 à Sèvre, à l’âge de 33 ans. Fils d’un commis des Postes, il fuit le Séminaire, échoue au baccalauréat et se lance jeune dans le journalisme, vivant pauvrement durant sa vie avec les maigres ressources de son travail journalistique. Jeune, il habite à Saint Nazaire en Bretagne et se lie d’amitié avec Aristide Briant, qu’il appuie dans ses premières campagnes politiques, tout en s’impliquant dans des revues et dans les Bourses du travail, alors naissantes à l’époque. En effet, il s’intéresse très tôt à l’importance stratégique des Bourses du travail et pousse en faveur de leur développement. Forcé à s’aliter durant longtemps, il lit beaucoup et formule progressivement les axes stratégiques fondamentaux à ses yeux pour la « révolution » et l’émancipation de la classe ouvrière, notamment la grève générale. Anticlérical, anti militariste et internationaliste, il se revendique rapidement de l’anarchisme.1 Il s’oppose à la stratégie illégaliste anarchiste de la « propagande par le fait » (les attentats individuels) des années 1892-1893, qu’il juge irresponsables. Il rejette aussi la voie légaliste et parlementaire (défendue par Briand ou encore Jaurès), aspirant à la démocratie directe. Hostile à tout pouvoir autoritaire et aux dogmes, il défend le syndicalisme d’action directe (basé sur l’auto-organisation et l’auto-émancipation de la classe ouvrière) comme voie à suivre et la grève générale comme but en soi. En 1895, il devient secrétaire de la Fédération des Bourses du travail et continue ainsi à mettre sa disponibilité matérielle et intellectuelle au service du syndicalisme français. Malgré tout, Pelloutier n’était pas un grand orateur, étant mal à l’aise devant les projecteur. Julliard note aussi qu’il n’était pas grand théoricien : sa pensée économique, par exemple, était assez simple et archaïque (chose que l’on peut aussi attribuer à son jeune âge). Il préfère le travail obscure et méthodique des tâches de coordination et d’animation sur le terrain et meurt discrètement à trente-trois ans. Dans un mouvement d’organisation syndicale qui s’inscrit dans la durée, les six années de travail accomplies par Pelloutier représentent peu de choses, et pourtant ses effort eurent un rôle fondamentale dans la structuration de tout le mouvement syndical français.
Comprendre les visées de l’action syndicale
Le syndicalisme consiste à unifier des groupes sociaux et des professionnel·le·s pour défendre leurs intérêts collectifs, au travers d’organisations qui prennent le nom de syndicats. En France, ces organisations deviennent légales en 1884 avec la loi Waldeck-Rousseau (même si cette loi comporte encore quelques restrictions). Rapidement, le syndicalisme tend à soutenir des objectifs politiques, de manière indépendante des partis politiques. Ces principes d’indépendances sont affirmés lors du Congrès de la CGT d’Amiens en 1906. Le syndicalisme d’action directe, aussi appelé « syndicalisme révolutionnaire » est alors très présent (et le sera jusqu’à la première guerre mondiale), préconisant l’auto-organisation et l’autonomie des travailleur·euse·s et la grève générale, en vue de détruire la société bourgeoise et le salariat – se distinguant du syndicalisme réformistes et des partis politiques.
Pour mieux comprendre le contexte de l’époque, quelques clarifications peuvent être utiles. Quels sont les objectifs de l’action syndicale ? S’agit-il de lutter pour l’amélioration des droits des travailleur·euse·s au quotidien et/ou bien de lutter pour la transformation radicale de la société, par exemple l’abolition du salariat et du patronat ? La transformation de la société passe-t-elle par des luttes quotidiennes pour l’amélioration des droits (c’est-à-dire des élections de représentant·e·s, des négociations avec la patronat, des manifestions ou encore des grèves, visant à établir des rapports de force en vue de négociations) ? Ou bien faut-il plutôt favoriser l’auto-organisation de la classe ouvrière ?
Certes, ces deux stratégies peuvent être complémentaires, mais de manière plus ou moins évidente selon les pays et les époques. Ainsi pour Pelloutier, l’action syndicale a pour objectif de transformer la société, et la stratégie à mettre en place n’est pas celle des grèves « partielles, qu’il juge inefficace et démobilisatrice. Pour lui, la stratégie à mettre en place est l’auto-organisation de la classe ouvrière, travail qu’il cherche à mener avec les Bourses du Travail.
Cette auto-organisation passe par la mise en place de services de mutualité (caisse de résistance, caisse d’assurance chômage, de maladie et de décès, enseignement professionnel, bibliothèque etc), mais aussi s’assurer que les statuts et règlements intérieurs sont écrits, que les cotisations sont fixées et collectées etc, en partant de l’idée que la classe ouvrière ne doit compter que sur elle-même.
La défense du syndicalisme de « l’action directe » : émancipation et auto-organisation
La visée de l’action syndicale visant le renversement de la société bourgeoise, Pelloutier défend un syndicalisme d’action directe (aussi appelé « syndicalisme révolutionnaire). Cette notion est ancienne mais est passée dans l’usage courant vers 1900. Elle reprend l’idée d’après laquelle, pour s’émanciper, la classe ouvrière doit créer ses propres conditions de lutte et moyens d’action. Comme par exemple, se doter de ses propres institutions : syndicats, Bourses du Travail, Fédération, avec des services de mutualité (office de recherche d’emploi, caisse de chômage, caisse de secours pour accident ou maladie). Pour Pelloutier, l’intérêt est avant tout pédagogique, visant à habituer les travailleur·euses·s à s’organiser en classe et à compter sur eux-mêmes. En effet pour lui, « seul l’homme instruit peut être maître de lui-même et susceptible de se passer de gouvernement ».
L’action directe se démarque ici de la voie législative et parlementaire. Pelloutier considère que les dirigeant(e)s politiques sont coincé·e·s dans un dilemme. D’un côté, en adoptant une posture réformiste, ces personnes se détournent des réformes réelles et radicales. De l’autre côté, la seule posture révolutionnaire au niveau législatif consiste à changer les personnes au gouvernement. Cette stratégie est à ses yeux insuffisante, puisqu’il considère que la délégation du pouvoir est une illusion. Pour Pelloutier, il faut donc choisir entre conquête des pouvoirs publics ou révolution syndicaliste. Il refuse l’argument que l’immaturité de la classe ouvrière justifierait qu’on lui substitue un parti ou une personnalité providentielle. Et c’est bien là tout l’enjeu de l’auto-émancipation : la classe ouvrière doit être consciente d’elle-même et agir par ses propres moyens.
Aujourd’hui le terme « d’action directe » peut renvoyer à un imaginaire de la violence. Pelloutier était en faveur du boycott et du sabotage, non pas comme manifestations d’une violence, brutale et irréfléchie, mais plutôt comme moyens d’auto-organisation de la classe ouvrière. A ses yeux, la révolution n’est pas un évènement ponctuel qui transformerait du jour au lendemain les mentalités et les structures sociales. C’est un travail patient d’organisation, d’éducation, d’autonomisation, qui doit permettre de remplacer les institutions centralisées et d’aller vers un vers un système fédératif d’institutions de production, basé sur la coopération et la mutualité.
La grève générale doit être synonyme de révolution
Pour Pelloutier, les grèves isolées et partielles ne sont pas des voies d’action à encourager. Il analyse les grèves menées à son époque et devant leur taux élevé d’échec, les juge coûteuses, stériles et démobilisatrices. Il en vient alors à cette conclusion : la pratique des grèves ponctuelles ne mènera pas à transformer réellement la condition ouvrière. Selon lui, « une grève qui échoue, c’est la misère dans les familles ouvrières ; une grève qui réussit, c’est la certitude d’une revanche patronale à brève échéance ». Les grèves partielles n’étant pas l’instrument de la révolution sociale, il faut alors se tourner vers la grève générale.
La grève générale puise son imaginaire dans la révolution française, la commune et d’autres expériences observées de l’étranger. Au milieu du XIXe siècle, cette idée prend la forme de grande fête de cessation du travail, ou encore de grève universelle. En 1868, les sections belges de la Première Internationale adoptent un vœu recommandant la grève générale, notamment pour s’opposer à la guerre. L’idée renaît aux Etats-Unis en 1884 avec la volonté de faire du 1er mai 1886 une grande journée revendicative pour l’obtention des huit heures. La grève générale n’est alors pas synonyme de révolution mais de moyen d’action. En France, certain·e·s, à l’instar de Fernand Pelloutier, de Joseph Tortellier ou du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, défendent ardemment la grève générale comme synonyme de révolution. Beaucoup rejettent cette idée, argumentant que la classe ouvrière n’est pas assez organisée. Il faut attendre la Charte d’Amiens de 1906, adoptée par la Confédération Générale du Travail (CGT), pour que cette stratégie soit adopté comme principe fondateur du mouvement ouvrier. Mais les différents échecs de grèves générales, notamment pour empêcher la première guerre mondiale, entrainent le déclin de ce qui était déjà à l’époque considéré comme un mythe révolutionnaire.
Pour le syndicalisme d’action directe, la grève générale vise la désorganisation de la production et de la circulation des personnes et des produits, ainsi que la prise de possession des instruments de production (grève expropriatrice). La grève générale ne doit pas nécessairement être une grève généralisée, elle peut être une grève des branches industrielles jugées stratégiques pour atteindre cet objectif. A ce titre, Pelloutier refuse la grève générale pacifique et se prononce en faveur du boycott et du sabotage.
La grève générale, synonyme de révolution, serait pour Pelloutier le résultat « d’une tension croissante qui conduit à une explosion », à laquelle il est nécessaire de se préparer. Et pour ce faire, il ne faut pas céder aux tentations des raccourcis autoritaires, comme par exemple en manipulant les travailleur·euse·s. Pour que la révolution soit synonyme d’émancipation, cette préparation méthodique doit être individuelle et collective, et les institutions syndicalistes, mutuellistes et coopérative doivent activement y participer : renforcement et coordination des syndicats, création de caisses de résistances, développement du réseau des Bourses de travail.
Abandonner les grèves partielles : la grève générale doit être synonyme de révolution
Pour Pelloutier, les grèves isolées et partielles ne sont pas des voies d’action à encourager. Il analyse les grèves menées à son époque et devant leur taux élevé d’échec, les juge coûteuses, stériles et démobilisatrices. Il en vient alors à cette conclusion : la pratique des grèves ponctuelles ne mènera pas à transformer réellement la condition ouvrière. Selon lui, « une grève qui échoue, c’est la misère dans les familles ouvrières ; une grève qui réussit, c’est la certitude d’une revanche patronale à brève échéance ». Les grèves partielles n’étant pas l’instrument de la révolution sociale, il faut alors se tourner vers la grève générale.
La grève générale puise son imaginaire dans la révolution française, la commune et d’autres expériences observées de l’étranger. Au milieu du XIXe siècle, cette idée prend la forme de grande fête de cessation du travail, ou encore de grève universelle. En 1868, les sections belges de la Première Internationale adoptent un vœu recommandant la grève générale, notamment pour s’opposer à la guerre. L’idée renaît aux Etats-Unis en 1884 avec la volonté de faire du 1er mai 1886 une grande journée revendicative pour l’obtention des huit heures. La grève générale n’est alors pas synonyme de révolution mais de moyen d’action. En France, certain·e·s, à l’instar de Fernand Pelloutier, de Joseph Tortellier ou du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, défendent ardemment la grève générale comme synonyme de révolution. Beaucoup rejettent cette idée, argumentant que la classe ouvrière n’est pas assez organisée. Il faut attendre la Charte d’Amiens de 1906, adoptée par la Confédération Générale du Travail (CGT), pour que cette stratégie soit adopté comme principe fondateur du mouvement ouvrier. Mais les différents échecs de grèves générales, notamment pour empêcher la première guerre mondiale, entrainent le déclin de ce qui était déjà à l’époque considéré comme un mythe révolutionnaire.
Pour le syndicalisme d’action directe, la grève générale vise la désorganisation de la production et de la circulation des personnes et des produits, ainsi que la prise de possession des instruments de production (grève expropriatrice). La grève générale ne doit pas nécessairement être une grève généralisée, elle peut être une grève des branches industrielles jugées stratégiques pour atteindre cet objectif. A ce titre, Pelloutier refuse la grève générale pacifique et se prononce en faveur du boycott et du sabotage.
La grève générale, synonyme de révolution, serait pour Pelloutier le résultat « d’une tension croissante qui conduit à une explosion », à laquelle il est nécessaire de se préparer. Et pour ce faire, il ne faut pas céder aux tentations des raccourcis autoritaires, comme par exemple en manipulant les travailleur·euse·s. Pour que la révolution soit synonyme d’émancipation, cette préparation méthodique doit être individuelle et collective, et les institutions syndicalistes, mutuellistes et coopérative doivent activement y participer : renforcement et coordination des syndicats, création de caisses de résistances, développement du réseau des Bourses de travail.
Les Bourses du travail : un enjeu stratégique majeur pour la révolution
L’organisation syndicale peut à la fois s’appuyer sur une structuration dite verticale, avec des regroupements syndicaux par fédérations de métiers et corporations, mais aussi par une structuration plus horizontale, avec un maillage géographique d’unions locales inter-métiers. Inspirées de cette seconde forme de structuration, les Bourses du travail cherchent à réunir sur un même territoire différents syndicats de métiers, tandis que les premières fédérations nationales de métiers voient le jour (pour la première, en 1886) et actent leur séparation des partis politique. Le mouvement des bourses du travail est alors récent, puisque la première Bourse du travail date de 1887 : afin d’aider les syndicats de métiers, le Conseil municipal de Paris leur met à disposition des bureaux, salles de réunion et centre de documentation pour se réunir. D’autres Bourses du travail se créent rapidement en France, et décident de se réunir en 1892 lors du Congrès de St Etienne, en créant la Fédération Nationale des Bourses du travail. Pelloutier s’engage tôt dans ce mouvement : il représente celle de Saint Nazaire puis devient secrétaire de la Fédération en 1895.
La révolution demande une préparation méthodique des structures mentales et des nouvelles institutions . Pour Pelloutier, les Bourses du travail doivent activement préparer la grève générale (donc la révolution) et être des outils de lutte, d’organisation et d’éducation de la classe ouvrière. En effet pour renforcer les syndicats, il faut organiser les travailleur·euse·s à la base, créer des conseils locaux là où les Bourses du travail ne sont pas encore établies. Ces lieux doivent servir à rapprocher différents corps de métier, à discuter des questions communes, à développer des sentiments de solidarité, à s’éduquer et s’émanciper. On y trouve ainsi des bibliothèques, des cours du soir (d’enseignement général et professionnel), qui forment à diverses fonctions sociales, comme par exemple la statistiques et l’économie. On y trouve aussi des bureaux de placements. Ces Bourses sont ouvertes à tout le monde et se transforment rapidement en « maisons du peuple », mettant en place des services de mutualité et de secours aux victimes d’accidents du travail et aux chômeur·euse·s.. Elle servent aussi à faire des enquêtes sur les conditions de travail, analyser et publier des statistiques sur le monde ouvrier.
Plus que secrétaire de la Fédération des Bourses du travail, Pelloutier se voit comme son porte-parole, refusant qu’elle ne devienne un organe centralisateur et bureaucratique. La fédération doit être l’instrument de coordination des initiatives locales et doit faciliter la circulation et l’échange des informations, comme un comité de liaison, non pas un organe exécutif qui décide et tranche. Il souhaite créer un comité central avec les représentant·e·s des Bourses et des fédérations, qui aurait pour mandat la préparation de la grève générale.
Julliard raconte qu’en 1901, la population active dans l’industrie en France s’élevait à 6 953 000 personnes, tandis qu’environ 1,25% de la population industrielle adhérait aux Bourses. A titre d’exemple, c’est bien moins qu’en Grande Bretagne puisqu’à la même époque, le Trade Union Council (l’organisation fédératrice des syndicats britanniques) représentait 1 200 000 membres. Ainsi, les personnes défendant l’intérêt stratégique des Bourses du travail étaient assez minoritaires. Pourtant, ce fut une « minorité agissante », qui exerça une véritable influence intellectuelle dans le syndicalisme français, et montra une grande confiance dans la capacité politique de la classe ouvrière.
L’enjeu de la coordination du mouvement syndical : naissance et croissance de la CGT
La question de la coordination (voir même de l’unification) des institutions syndicales se posent rapidement. En effet, d’un côté la Fédération des Bourses du travail a une base géographique et vise à multiplier les Bourses du travail sur le territoire. De l’autre côté, la Fédération nationale des syndicats (fondée en 1886) fonctionne par regroupement de professions et cherche à les organiser.
C’est de la rencontre entre ces forces syndicales que naît, en 1895, à Limoge, la Confédération Général du Travail, constituée de plusieurs syndicats de branche et de métiers, de chambres syndicales isolées et de Bourses du travail. Pelloutier s’oppose à cette logique de rassemblement, cherchant à conserver l’autonomie de la Fédération des Bourses du travail. Car si les partisan·ne·s de la CGT souhaitent en faire l’organe fédérateur de tout le syndicalisme français, Pelloutier reproche rapidement à la confédération la démesure de ses ambitions, jugeant la structure disproportionnée face à la faiblesse de ses moyens. Il craint aussi qu’elle ne devienne un organe tentaculaire, sorte de gouvernement de la classe ouvrière, lui qui cherche justement à combattre la tentation bureaucratique et autoritaire au sein du prolétariat organisé. Il souhaite que la CGT soit la rencontre temporaire entre le Fédération de la Bourse des travail et le Conseil National Corporatif, c’est-à-dire un organe souple, ne demandant pas de structure permanente ni de budget, simple organe de coordination de deux organismes indépendants.
Malgré ces inquiétudes, la CGT prend son essor et, suite à la mort de Pelloutier, la fusion totale de la Fédération des Bourses du travail et de la CGT est décidée en 1902. La tendance révolutionnaire, prônant l’action directe et la grève générale et refusant l’action parlementaire, est alors largement majoritaire. Cette orientation anarchiste du syndicalisme français est singulière en Europe. Mais les difficultés d’organisation soldent les tentatives de grève générale par des échecs et la politique de la CTG prend finalement une tournure plus réformiste avec l’arrivée de Léon Jouhaux comme secrétaire, en 1909.
Pas de révolution sans éducation et mémoire
Pelloutier est un militant syndicaliste anarchiste mais il est aussi journaliste. Pour lui, ces deux activités sont complémentaires et nécessaires. En effet, il considère que la transformation de la condition ouvrière nécessite une compréhension quasi scientifique de cette réalité, car il faut donner à l’ouvrier·e « la science de son malheur », qui est un malheur historique. Cela implique de comprendre le présent, mais aussi les expériences passées, positives comme négatives. C’est pourquoi il écrit et publie en 1900 avec son frère « Vie ouvrière en France », un ouvrage qui plonge dans le quotidien ouvrier français et s’intéresse à la durée du travail, aux salaires, au travail des femmes et des enfants, à la mortalité professionnelle, au budget des ouvrier·e·s et au coût de la vie, au chômage et à la misère, à l’alcoolisme… Rappelons que nous sommes à une période où la condition ouvrière reste largement ignorée du grand public et des intéressé·e·s eux/elles-mêmes. Pelloutier consacre aussi une grande partie de son énergie au journalisme, considérant que les journaux doivent participer au développement du mouvement syndical et coopératif : pas de révolution sans éducation, pas d’éducation sans journaux indépendants, qui diffusent des idées anti-militariste, anti-colonialiste, anti-parlementariste et documentent les luttes ouvrières, pour ainsi servir d’archives. Fervent partisan de l’enquête empirique, il devient d’ailleurs enquêteur à l’Office du travail en 1899 (notons que le poste d’archiviste, qui était dans le composition de nombreux bureaux syndicaux, disparait après 1900). La fin de la vie de Pelloutier est en partie dédiée à la création du journal « L’Ouvrier des Deux Mondes », dont l’objectif est de donner une biographie à la classe ouvrière et ainsi, nourrir sa mémoire collective.
Qui dit mémoire dit transmission et éducation, nécessaire aux yeux de Pelloutier pour lutter contre l’idéologie bourgeoise et pour préparer une société de personnes libres et fières, agissant par eux/elles-mêmes. Il faut donc donner une importance centrale à la formation et à l’éducation, en accord avec les principes d’auto-émancipation. Les Bourses du travail doivent être au service de cet objectif, avec des bibliothèques, des musées du travail, des cours d’enseignement général et professionnel. C’est là la force du syndicalisme d’action directe : « c’est à la classe ouvrière elle-même qu’il appartient de rechercher et de trouver les moyens et les ressources nécessaires à l’extinction de la misère ».

Cet article de l'Université Populaire des Luttes
Pistes de réflexion
Ce livre, paru en 1970, nous plonge dans la courte vie de Pelloutier et nous propose une belle frise historique du mouvement ouvrier français de l’époque. Julliard s’appuie de manière précise sur de nombreux écrits, et se refuse à une héroïsation de Pelloutier. Si l’ouvrage ne porte pas directement sur la grève générale et les Bourses du travail, il en constitue une belle porte d’entrée et permet de mieux comprendre le syndicalisme actuel ainsi que certains grands mythes, tel que celui de la grève générale. Ce livre a le mérite de prendre à bras le corps la question de l’idéalisme et de confronter les grands idéaux au réel. Si l’idée de grève générale est souvent présente dans les mouvements sociaux, cet ouvrage nous permet de comprendre que la concrétisation de cette utopie demande une organisation collective méthodique, et donc du temps. Pelloutier dédia une grande partie de sa courte vie à rendre plausible ce programme révolutionnaire, en poussant pour la multiplication de Bourses du travail, pour leur coordination et pour le développement de services de mutualité et de solidarité (caisse de grève, caisse d’assurance maladie, service de placement, bibliothèques etc). En accord avec ses idéaux anarchistes, il croyait profondément à l’auto-émancipation et l’auto-organisation de la classe ouvrière. Grâce aux comptes rendus des Congrès, on comprend bien les obstacles à l’organisation collective auxquels Pelloutier a fait face et le travail colossal, et lent, qui a été nécessaire pour convaincre ses camarades éviter les formes d’organisations trop hiérarchiques, bureaucratiques et sclérosées.?
En fin de lecture, des questionnements émergent, notamment : qu’est-il censé advenir après la grève générale? Certes, elle demande une autonomisation de la classe ouvrière et une préparation minutieuse de la révolution, et nous sommes loin d’une défense de l’insurrection spontanée, qui viendrait comme par enchantement résoudre les problèmes de notre société. Mais qu’est-il censé advenir suite à l’expropriation des moyens de productions du pays ? Julliard reconnait que l’analyse de Pelloutier et de ses contemporains n’est pas très développée sur ce point. Le jeune anarchiste, influencé par Bakouine, défend une société d’association de producteurs·rice·s, mais nous n’en savons pas beaucoup plus, si ce n’est que Pelloutier accordait une importance centrale à l’apprentissage des statistiques, afin que les ouvrier·e·s soient en capacité de prendre en charge ces questions. On peut aussi s’accorder sur le fait que les efforts apportés au développement concret et précis des conditions d’ émancipation des ouvrier·e·s étaient déjà révolutionnaires en eux-mêmes.?
Ce livre nous apporte aussi du recul face au syndicalisme actuel et aux potentielles tentatives d’auto-organisation des travailleur·euse·s. Aujourd’hui, en France, les syndicats de métier ont perdu une grande partie de leur base militante, et beaucoup de Bourses du travail sont devenus des simples lieux de réunions entre syndicats. Pelloutier défendait des Bourses de travail qui soient des lieux de convergence des luttes, d’éducation populaire et de solidarité. On peut se demander où sont ces lieux aujourd’hui et quelles formes ils ont pris, en dehors du monde syndical. Car si les Bourses du travail remplissent difficilement leurs missions intitiales, d’autres initiatives ont vu le jour et les tentatives de créer des « maisons du peuple » sont (et ont été) nombreuses, passant par le mouvement squat à la création de nombreux tiers-lieux. La lecture de cet ouvrage donne envie de creuser ces pistes : à quoi ressemblent les maisons du peuple actuelles ? Quels sont leurs objectif et leur stratégie ? Ces différents lieux collectifs sont-ils en lien, partagent-ils des objectifs et une stratégie commune ? Ou bien leur multiplication est-elle une fin en soi ? À quoi ressemblerait une plus grande convergence des luttes ?
Ce livre nous pousse aussi à nous interroger sur le mouvement syndical français actuel. La grève générale est un mythe et les stratégies de luttes ont bien évoluées. Si la CGT défendait à sa naissance un projet de société révolutionnaire et la grève générale, c’est-à-dire la révolution, ce ne sont plus les revendications des syndicats actuels. Le mouvement syndical français est fractionné, rendant difficile une convergence des luttes syndicales et la construction d’un mouvement social d’ampleur, pouvant porter des revendications radicales. Les stratégies de confrontation et de rupture ont donné place à des stratégies de négociations, ce qui interroge la capacité des syndicats d’aujourd’hui à construire d’authentiques contre-pouvoirs.?

L'Université Populaire des Luttes
Traduire, rechercher, mettre en page et faire vivre notre communauté de bénévoles permet de garder en mémoire les récits de luttes, sources inépuisables d’espoirs et d’inspirations tactiques et stratégiques.
Dans un système politique prédateur dont l’un des objectifs est de nous priver de nos repères militants historiques, les moyens de financer ce travail de mémoire sont rares.
Pour nous aider à garder cette université populaire des luttes accessible gratuitement et contribuer à renforcer nos luttes et nos solidarités, faites un don !
VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE
ET VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN ?
On a bien réfléchi et on vous propose de lire celui-ci, qui est très complémentaire.

QU’EST-CE QUE LA GRÈVE GÉNÉRALE ?
Leçon faite par un ouvrier aux docteurs en socialisme par Henri Girard et Fernand Pelloutier.

QU’EST-CE QUE LA GRÈVE GÉNÉRALE ?
Leçon faite par un ouvrier aux docteurs en socialisme par Henri Girard et Fernand Pelloutier.