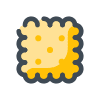Être radical
Manuel pragmatique pour radicaux réalistes
Saul Alinsky
 FICHE DE LECTURE
FICHE DE LECTURE
Par Chloé Rousset | Mars 2021
Contexte
Après avoir étudié la sociologie et la criminologie à Chicago, Saul Alinsky a consacré toute sa vie à l’organisation politique des personnes, notamment des habitant·e·s les plus pauvres de Chicago, pour qu’elles parviennent à changer par elles-mêmes leurs conditions de vie. 25 ans après la publication d’un premier ouvrage (« Radicaux, réveillez-vous ! », 1946), Alinsky s’adresse de nouveau à celles et ceux qui luttent pour des sociétés plus justes, s’appuyant sur sa large expérience de « community organizer ». Le contexte sociopolitique des États-Unis de l’époque est alors tout aussi enflammé qu’aujourd’hui (Black Panthers, luttes dans les ghettos, guerre du Vietnam, Weather Underground1, grèves générales, etc..) et Alinsky, qui se surnomme lui-même le « Machiavel des pauvres », propose des conseils pragmatiques pour s’organiser et obtenir des victoires.
Synthèse
Dans cet ouvrage, Alinsky s’adresse aux jeunes générations désabusées, en quête de sens et de changements. Or, pour changer l’ordre établi, il est nécessaire d’analyser et de construire du pouvoir en s’organisant collectivement, pour mener des actions collectives stratégiques. Le rôle d’un·e organisateur·ice est alors d’accompagner le développement de ce pouvoir, ce qui demande d’adopter une approche pragmatique des luttes et de sortir de la simple rhétorique. Cela signifie travailler avec tout le monde, surtout avec la « majorité silencieuse », pour les radicaliser et former des alliances. Car il s’agit de construire une base réformiste qui soutiendra de vraies révolutions politiques plutôt qu’elle n’aille grossir les rangs des organisations opposées au respect de la dignité de tout·e·s. Un tel travail demande du temps, de la patience, de la rigueur, de l’humilité, des victoires et des échecs.

Vous aimez nos contenus ? Pourquoi ne pas vous y abonner ?
Les idées à retenir

Il nous faut partir du monde tel qu’il existe plutôt que tel que l’on voudrait qu’il soit : une arène de pouvoir politique, dominée par les intérêts particuliers

Il est utile de reconnaître le concept de contradiction et de complémentarité : rien de positif n’arrive sans quelque chose de négatif. Toute révolution implique une contre-révolution, l’enjeu est d’apprendre à l’anticiper.

Avant de juger une action, il s’agit de comprendre son contexte (« est-ce que cette fin particulière justifie ce moyen particulier » ?)

Il est important de se réapproprier des mots qui nous font peur : « pouvoir », « conflits », « intérêt particulier », « le compromis ».

Curiosité et imagination, refus du dogme, sens de l’humour, humilité, flexibilité et fort sens de l’organisation sont nécessaires pour remplir son rôle d’agitateur·ice-organisateur·ice et parvenir à développer du pouvoir collectif.

Le premier travail d’un·e organisateur·ice invité·e au sein d’un groupe est de remettre en question le sentiment d’impuissance et d’apathie résultant de l’organisation d’une communauté préexistante. Il s’agit donc d’aller la désorganiser et l’agiter, en insistant sur les problèmes précis et en montrant qu’il est possible de faire quelque chose. C’est une fois que nous reprenons confiance en notre capacité d’agir et de changer les choses que nous nous questionnons, organisons et bataillons pour obtenir des victoires.

L’hostilité des personnes vis-à-vis d’un·e organisateur·ice vient souvent d’un sentiment de frustration, « pourquoi ne l’avons-nous pas fait avant ? ». Il est nécessaire de ne pas se perdre dans les méandres de cette discussion pour se recentrer sur le besoin d’organisation et canaliser les énergies dans cet effort.

Le seul compas moral à avoir est celui du respect de la dignité des personnes. Imposer ses sentiments, ses idées, ses besoins et ses expériences à autrui contrevient à cela. Les personnes ont le droit fondamental de pleinement participer à la résolution de leurs problèmes.

Pour penser des tactiques et faire face à l’imprévisible, l’imagination et la prise de recul sont nos meilleurs alliés.
Pour approfondir
Difficile de faire un résumé de « Rules for Radicals » tant il fourmille d’exemples et d’expériences ! Il s’agit de l’ouvrage d’un praticien qui a trente ans d’expérience avec lui et qui se refuse à faire une « science » du community organizing. C’est pourquoi nous avons fait le choix de développer quelques chapitres du livre que nous avons trouvé particulièrement pertinents pour mieux comprendre sa pensée. Par souci de lisibilité et de synthèse, le choix a été fait de se centrer sur la théorie et de ne garder que quelques exemples.
Le débat sur la fin et les moyens : l’approche pragmatique d’une éthique à géométrie variable
La fin justifie-t-elle les moyens ? Il s’agit d’un grand débat dans le champ de l’éthique, car tout choix tactique implique de peser moralité et efficacité. Or, pour Alinsky, ce débat manque de pragmatisme.
Tout d’abord, il observe que le jugement de l’éthique des fins et des moyens dépend de la position politique de celle et ceux qui exercent ce jugement et que ce jugement ne doit être fait que dans le contexte de l’action. Par exemple, la résistance à l’occupation nazie, qui impliquait assassinat, destruction de biens, enlèvements, et sacrifice… Pris hors contexte, ces actes peuvent être jugés immoraux et donc à bannir. Mais dans un contexte d’autodéfense (ici, il n’y a pas le luxe du choix, car les moyens disponibles sont très limités) et de lutte contre le totalitarisme, difficile de les remettre en question. Toutefois, ces actes, bien que célébrés par la Résistance, furent dénoncés par l’occupant nazi : pour Alinsky c’est encore une fois une question de contexte et de positionnement. L’auteur analyse ainsi le fait qu’en réalité, le débat sur la moralité d’une action va grandement dépendre de son succès ou de son échec. (car au final toute action est jugée illégitime par ses adversaires). Ainsi, pour Alinsky, la vraie question qui doit guider ce débat éthique est : « est-ce que cette fin particulière justifie ce moyen particulier » ?
Se réapproprier des mots
Bien des mots dans le vocabulaire de la révolution sont mal connotés et renvoient à des imaginaires non désirables. Pour Alinsky, l’organisateur doit interroger ces mots et leur sens afin de cesser d’en avoir peur et de se les réapproprier. En voici quelques exemples :
Pouvoir : associé à la coercition, à la hiérarchie, à la violence et à la corruption, le pouvoir est pourtant un mot polysémique et à la base de tout mouvement de vie. Il est essentiel de comprendre le pouvoir, pour ne pas en avoir peur et être capables de l’utiliser à notre tour.
Intérêt particulier (self-interest) : souvent associé à l’égoïsme et opposé à l’altruisme. Pourtant ce n’est pas l’altruisme qui guide nos choix, mais bien nos intérêts particuliers, écrit Alinksy.
Compromis : terme associé à la faiblesse, à la trahison de ses idéaux et de ses principes moraux. Pourtant, pour un·e organisateur·ice, le compromis est central. Une société libre et ouverte repose sur le conflit continu et donc sur la recherche de compromis. C’est un cycle permanent.
Ego : il s’agit pour Alinsky du désir de créer, non pas de l’arrogance. C’est quelque chose de positif, qui demande de se respecter soi et de croire en soi afin de pouvoir respecter les autres et de croire en elles/eux.
Conflits : sans conflit, pas de démocratie. Les conflits sont des viviers de créativité.
Les qualités d’un·e organisateur·ice
La raison d’être des organisateur·ices est de développer du pouvoir chez les autres et d’accompagner la création et le développement d’organisations, qui mèneront des combats. Comment devenir organisateur·ice ? Fort de ses trente ans d’expérience, Alinsky répond qu’il n’y a pas de secret : les choses se répètent rarement deux fois et il n’y a pas de « science » de l’organisation pour nous aider face à l’imprévisible. On apprend en expérimentant. Ce constat posé, Alinsky réfléchit à l’idéal type d’un·e organisateur·ice, question qu’on lui a mainte fois posée. Un exercice difficile et hors sol comme lui-même l’admet, mais qui lui permet de poser quelques bases et notamment les valeurs qui doivent soutenir le travail. Ainsi, quelles sont les caractéristiques nécessaires à un·e organisateur·ice ?
Tout d’abord, il faut faire preuve de curiosité et d’imagination. Nous pensons souvent que c’est la colère et le sentiment d’injustice qui nous poussent à agir. Pour Alinsky, c’est avant tout notre imagination qui compte, car c’est grâce à cela nous nous identifions à autrui, que nous partageons sa colère et sa souffrance et que nous pouvons ensuite nous organiser ensemble. Ensuite, il y a le refus du dogme, car la tâche centrale de l’organisateur·ice est de questionner, agiter, discréditer. Le « pourquoi » est sa boussole. Le sens de l’humour est aussi crucial pour prendre de la distance et apprendre l’humilité – la tentation que le pouvoir nous monte à la tête est forte, il faut constamment s’en méfier et se remettre en question. Ensuite, pour aller « désorganiser » des situations, il est nécessaire d’être soi-même bien organisé·e et d’avoir confiance en ses compétences – ce qui ne signifie pas être égoïste ou narcissique. Enfin, lorsqu’un imprévu arrive, c’est une mentalité libre, ouverte, souple et créative qui nous permettra de nous en sortir, non pas l’amertume, le cynisme et la désillusion.
Comment communique-t-on ?
Que signifie communiquer ? Cette question est centrale, car si un·e organisateur·ice ne parvient pas à communiquer avec autrui, elle ne peut faire son travail. Si les personnes ne comprennent pas ce que dit l’organisateur·ice, si elles ne se sentent pas touchées par des problèmes, si elles ne comprennent pas le rôle qu’elles peuvent jouer pour changer une situation, alors l’effort d’organisation n’aboutira pas. Communiquer, pour Alinsky, c’est parvenir à se connecter à une expérience que l’autre a vécue, et nous ne comprenons que ce que nous avons nous-mêmes vécu. Mais alors comment faire concrètement ? L’auteur explore plusieurs pistes.
Première piste : parler en dehors de sa propre expérience ou de l’expérience de l’autre ne mènera pas loin, et la communication sera difficile. Afin de trouver une expérience commune dans laquelle chacun·e puisse se projeter, Alinsky explore plusieurs pistes, dont l’une est de créer cette expérience de toutes pièces. Cherchant à expliquer cette idée à ses collègues, il raconte l’anecdote suivante : dans un quartier bourgeois de Los Angeles, Alinksy est allé proposer un billet de 10 dollars aux passant·e·s. Après une dizaine de tentatives, personne ne l’avait pris. L’organisateur fut soit ignoré, soit pris pour un fou, soit pris pour quelqu’un cherchant des services sexuels mais jamais pour une personne voulant tout simplement donner 10 dollars à autrui, car cet acte n’appartient pas à notre expérience commune. Une fois cette expérience terminée, ses collègues avaient mieux compris l’idée que les réactions des personnes se basent sur leur propre expérience.
Deuxième piste : chercher à communiquer avec autrui en invoquant des idéaux (par exemple, l’idéal de justice) ou encore des statistiques aura peu de chance de fonctionner. Il faut revenir à l’expérience des personnes et à leurs intérêts particuliers pour les toucher. Il prend l’exemple d’étudiant·e·s parlant à des personnes précaires, pour leur expliquer que trouver un travail, acheter une maison, une télé, une voiture ne leur apporteront pas le bonheur. Ici, la communication est un échec puisque l’organisateur·ice est complètement en dehors de l’expérience des personnes (« ok, laisse-moi être juge de ça, je te le dirais une fois que j’aurai eu tout ça »). De la même manière, parler de la mort de millions de personnes n’entre pas dans l’expérience des personnes, c’est une statistique. Par contre, parler de la mort d’une personne chère va faire écho à des expériences vécues, car nous réagissons à des relations personnelles. Ainsi, communiquer sur la bombe atomique est difficile, car c’est trop abstrait et va bien trop loin en dehors de l’expérience des personnes. Il faut revenir dans le concret, s’ancrer.
Troisième piste : une communication fluide et honnête dépend de la force de la relation créée et du degré de confiance instauré. Alinsky prend l’exemple du temps où il travaillait avec le quartier « Back of the Yards », à Chicago, dans lequel l’Église catholique romaine avait beaucoup d’influence. Il explique avoir eu envie de parler de l’importance du droit à l’avortement et des moyens de contraceptions, voyant les situations économiques terribles de familles très nombreuses dans le quartier. Conscient qu’il se serait mis à dos l’Église et ses croyant·e·s et que la communication aurait été rompue, il ne dit rien. Et ce n’est que plusieurs années plus tard, une fois que de solides relations eurent été construites, qu’il put se permettre d’avoir de telles discussions.
Dernier enseignement central pour Alinsky : bien communiquer avec autrui signifie l’encourager à prendre confiance en elle/lui, en ses idées, en ses analyses et en ses décisions. C’est central, car il ne faut pas que les personnes et le groupe développe une dépendance vis-à-vis de l’organisateur·ice. La maïeutique socratique est ici utile : « Pourquoi dis-tu cela » ? « Qu’en penses-tu ? ». Il s’agit de renvoyer la balle à autrui, en utilisant des questions ouvertes pour que les personnes osent s’affirmer, se questionnent et assument leurs propos et actions.
Comment réussir à développer du pouvoir et à organiser ?
Qu’est-ce qui fait que le travail d’un·e organisateur·ice fonctionne et parvient à construire du pouvoir ? À nouveau, Alinksy propose plusieurs pistes de réflexion :
Première piste : sans légitimité, le travail est voué à l’échec. Par exemple, Alinksy explique qu’un·e organisateur·ice gagne en légitimité lorsqu’elle est invitée par un groupe. Imposer sa présence ne mènera nulle part. Et pour être invité·e, il faut que la raison d’être de son travail soit comprise par le groupe. Il faut aussi réussir à leur prouver qu’elle est de leur côté et qu’elle sait comment se battre pour que les choses changent. Sinon, pourquoi aurait-on besoin d’un·e organisateur·ice ?
Deuxième piste : un·e organisateur·ice réussira à faire son travail si elle parvient à s’attaquer au sentiment d’impuissance et à l’apathie résultant de l’organisation préexistante de la communauté. Il s’agit donc d’aller désorganiser, agiter tout ça, en mettant le doigt sur des problèmes précis, en montrant qu’il est possible de faire quelque chose et que ce quelque chose est à notre portée. En effet pour Alinsky, quand les personnes sentent qu’elles n’ont pas le pouvoir de faire changer les choses, alors elles n’y pensent pas. C’est une fois que nous avons l’opportunité d’agir et de changer nos conditions de vie que nous commençons à voir et analyser les problèmes, à prendre conscience de nos compétences, que nous posons les bonnes questions, que nous nous organisons, que nous prenons des risques – que nous gagnons, échouons, apprenons et continuons.
Troisième piste : pour réussir son travail, il faut toujours revenir au but premier, à savoir s’organiser pour créer du pouvoir collectif et gagner des victoires. Alinsky prend l’exemple de ce qu’il appelle les « tentatives de rationalisation ». Quand un·e organisateur·ice commence son travail, c’est-à-dire venir mettre du désordre dans l’ordre établi pour amener les personnes à agir, une question se pose souvent : « pourquoi ne pas l’avoir fait avant ? Pourquoi avons-nous été dans l’apathie jusqu’à présent ? ». C’est un mécanisme de défense normal (qu’il appelle « tentative de rationalisation ») qui peut avoir comme conséquence un sentiment de méfiance et d’hostilité vis-à-vis de l’organisateur·ice. Il nous faut apprendre à le reconnaître pour ne pas se perdre dans les méandres de justifications hasardeuses et revenir au but premier du travail et donc, canaliser le sentiment d’hostilité et de frustration dans l’organisation.
Quatrième piste : pour que le travail d’organisation fonctionne, il faut que l’organisateur·ice accompagne le groupe dans des batailles qui peuvent être gagnées. En effet, le plus gros travail d’un·e organisateur·ice est de construire de la confiance en soi et dans le collectif. Chaque petite victoire va renforcer ce sentiment de puissance et l’idée qu’il est possible d’aller plus loin. Si la première bataille menée est trop grande et l’objectif irréalisable, le sentiment d’impuissance revient.
Quel compas moral ?
Ce travail d’organisation est-il mené par un compas moral ? Seul le respect de la dignité des individus compte, écrit Alinsky. Respecter la dignité des individus, c’est ne pas confondre ses émotions, ses vécus, ses expériences et ses désirs avec ceux d’autrui, et encore moins les imposer. C’est respecter les choix qu’autrui fait, même si ce ne sont pas les siens – sauf si ces choix ne respectent pas la dignité d’autres individus. C’est finalement le principe d’auto-organisation des personnes concerné·e·s qui en découle, et le droit fondamental de participer pleinement à la solution des problèmes qui nous concernent directement. Et plutôt que de venir imposer sa vision des choses, il s’agit d’accompagner ces questionnements, afin que les personnes puissent émettre des jugements informés et éclairés.
Comment penser nos tactiques ?
Alinsky refuse de faire de son livre un manuel tactique, puisqu’une situation se répète rarement deux fois : ce qui compte, c’est l’imagination. Mais de nombreuses personnes lui ayant demandé de partager des conseils tactiques, il décide tout de même de s’y attarder. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour réaliser une tactique efficace.
Premièrement, Alinsky insiste sur le fait que notre pouvoir réside moins dans ce que nous avons que ce que l’ennemi pense que nous avons. Mais attention, le pouvoir de la menace n’est réel que si l’ennemi pense sérieusement que nous pouvons et que nous allons mettre à exécution notre plan. Deuxièmement, il faut constamment réussir à prendre par surprise nos opposant·e·s ( et ici l’imagination est encore une fois nécessaire). Troisièmement, il faut que l’action enthousiasme les personnes et reste dans leur champ d’expérience, sinon elle aura bien du mal à fonctionner. Quatrièmement, la temporalité de la tactique est centrale, qu’il s’agisse d’un boycott, d’un sit-in, etc. Une action trop longue et monotone prendra trop d’énergie aux participant·e·s, qui ne resteront pas. À nouveau, il faut faire preuve d’imagination pour transformer cela en force. Cinquièmement, des revendications et propositions doivent être prêtes en cas de victoire. Et il faut aussi être en capacité de maintenir la pression pour s’assurer que ces propositions soient mises en œuvre. Enfin il faut choisir sa cible. Il est trop simple de dire « je vous entends, mais je ne suis pas responsable ». C’est une stratégie amplement utilisée. Pour ne pas se perdre là-dedans, choisir une cible, se focaliser sur celle-ci est nécessaire.
Alinsky prend de nombreux exemples pour illustrer ces propos. Nous proposons d’en donner un, qui illustre plusieurs de ces points. L’organisation de Woodlawn de Chicago voulait que le maire de la ville réponde à leurs revendications. Une première idée fut d’aller occuper la mairie de la ville. Mais après deux ou trois heures, le risque était qu’il ne reste que 800 des 5000 personnes – parties car fatiguées ou s’ennuyant. Le maire n’aurait alors eu qu’à attendre encore un peu que la mairie se vide et la tactique aurait été un échec. L’organisation opta donc pour une autre option : arriver en force à la mairie avec 5000 personnes, et exiger du maire qu’il réponde rapidement à leurs demandes, le menaçant de venir avec encore plus de monde la prochaine fois. La foule repartie, toujours enthousiaste et puissante, laissant les autorités pétrifiées.
Enfin, l’auteur nous met en garde contre un risque : enchainer les actions sans prendre de recul. . Il est central d’apprendre à faire un pas de côté, prendre du recul et interroger nos approches. Prendre le temps de comprendre nos réussites et nos échecs pour mieux adapter nos tactiques d’action requiert du temps – chose difficile face au sentiment d’urgence permanent – mais c’est nécessaire.

Cet article de l'Université Populaire des Luttes
Pistes de réflexion
« Être radical » est un livre riche en enseignements et partage d’expériences. Refusant d’en faire un manuel du/de la bon.ne révolutionnaire, Alinsky nous parle de manière lucide et sincère de ses croyances, de ses victoires et de ses échecs. Mettant de côté l’idéalisme qu’il juge stérile, cet ouvrage est un appel à l’action et à l’organisation et surtout, un rappel que le changement viendra par l’auto-organisation des personnes concernées. Le partage et les analyses de ses propres expériences donnent une dimension très concrète à ses propos, en accord avec son idée que les actions ne doivent être jugées que par leurs conséquences. C’est ici un premier écueil de son approche : un compas moral trop peu développé. Adepte du conséquentialisme (une action ne peut être jugée que d’après ses conséquences – échec ou succès), tout dépend d’une situation concrète. Ce positionnement, très présent dans le monde anglo-saxon (culture du résultat et de la compétition), peut pourtant faire passer les valeurs morales à la trappe, au nom de la défense des intérêts particuliers. Ainsi, Alinsky ne prend pas la peine de définir ce qu’il entend par « justice » dans son ouvrage. Il parle de la défense de société « libre et ouverte », sans pour autant donner plus de détail. Aujourd’hui aux États-Unis, les méthodes du community organizing sont ainsi utilisées par les mouvements en faveur de la justice sociale, mais aussi par des mouvements autoritaires, réactionnaires et racistes. Une méthodologie qui ne se base pas sur des valeurs éthiques fortes et qui ne met pas au centre l’éducation populaire politique prend le risque d’être récupérée par des luttes bien éloignées de la recherche du bien commun et de la justice.
Enfin, une approche féministe, intersectionnelle2 et basée sur l’éthique du soin3 nous permet de prendre du recul sur les réflexions d’Alinsky. Notons qu’il cite à plusieurs reprises des exemples sexistes (un exemple au chapitre sur la communication, quand il explique que les blagues sexistes sont un bon moyen de créer de la complicité – entre hommes de toute évidence), et construit un imaginaire viriliste. Son vocabulaire est assez guerrier (il faut vaincre, s’armer, être efficace, ne pas être faible, ne pas avoir peur de manipuler autrui) et son ton, paternaliste envers les jeunes militant·e·s « radicaux » et « radicales », dont il juge le positionnement et les tactiques avec un mélange de pitié et de mépris. Certes, sa boussole morale est « le respect de la dignité des personnes ». Cependant, il a une compréhension assez limitée de ce que signifie « la dignité » des personnes. En bref, Alinksy semble plutôt s’adresser à des organisatEURS, adepte d’humour oppressif et prêts à montrer du muscle. Ce qui illustre bien notre deuxième point, à savoir son approche limitée du pouvoir. En dépit du fait que le mot « pouvoir » soit souvent surligné, il ne cherche pas à le déconstruire véritablement. Que signifie le concept de pouvoir ? N’existe-t-il pas plusieurs formes de pouvoir ? Alinsky parle beaucoup de pouvoir qui s’avère être un pouvoir « sur » (celui des « gens-qui-ont » sur « les-gens-qui-n’ont-pas »), mais il serait intéressant d’approfondir avec une analyse du pouvoir collectif/relationnel. C’est-à-dire un pouvoir qui se base sur des liens de confiance, de solidarité, de valeurs partagées (et pas juste d’intérêts particuliers). L’organisation collective vise-t-elle finalement à obtenir des revendications et/ou à déconstruire un pouvoir toxique et oppressif ? Ici, on voit bien que les valeurs sont nécessaires et que « partir du monde tel qu’il est » implique aussi son corollaire, à savoir imaginer le monde que l’on souhaite. Lui qui parle tellement d’imagination ! Si nous souhaitons un monde plus juste, équitable, qui respecte la dignité d’autrui sous toutes ses formes, alors je dois m’attaquer au pouvoir « sur », celui qui écrase. Et je dois m’y attaquer au sein même des organisations dans lesquelles je travaille. Cela implique de remettre de l’humain dans la relation que je tisse avec les autres (et non pas de les voir comme de simples chiffres), de lutter contre les comportements toxiques et d’imaginer des formes d’organisation qui respectent la dignité de chacun·e. L’éthique du soin et les réflexions autour de l’intersectionnalité – c’est-à-dire un travail de déconstruction des oppressions – sont nécessaires pour approfondir ces enjeux et repenser sa posture d’organisateur·ice.

théoricienne de l’intersectionnalité.
Crédit : UCLA School of Law
L'Université Populaire des Luttes
Traduire, rechercher, mettre en page et faire vivre notre communauté de bénévoles permet de garder en mémoire les récits de luttes, sources inépuisables d’espoirs et d’inspirations tactiques et stratégiques.
Dans un système politique prédateur dont l’un des objectifs est de nous priver de nos repères militants historiques, les moyens de financer ce travail de mémoire sont rares.
Pour nous aider à garder cette université populaire des luttes accessible gratuitement et contribuer à renforcer nos luttes et nos solidarités, faites un don !
VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE
ET VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN ?
On a bien réfléchi et on vous propose de lire celui-ci, qui est très complémentaire.

COMMUNITY ORGANIZING : POURQUOI IL FAUT OUBLIER SAUL ALINSKY
Saul Alinsky, c’était intéressant. Mais nous, on est passés à autre chose.

COMMUNITY ORGANIZING : POURQUOI IL FAUT OUBLIER SAUL ALINSKY
Saul Alinsky, c’était intéressant. Mais nous, on est passés à autre chose.