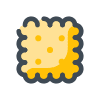Entretien Lumir Lapray : dans les coulisses de “Fight For 15”
Entretien et retranscription réalisés par Sergio Maviel, Chloé Rousset et Jean-Michel Knutsen

En 2015, le salaire minimum des travailleur·ses de Los Angeles a doublé, passant de 7,25$ par heure à 15 $ de l’heure. Derrière cette victoire impressionnante se cache un impressionnant travail d’organisation collective, réalisé grâce à la campagne “Fight for Fifteen”. Lumir Lapray y a participé pendant un an, alors qu’elle était étudiante en échange en Californie. Elle nous raconte aujourd’hui les coulisses de cette campagne et nous partage ses réflexions sur sa mise en œuvre : une stratégie éloignée du modèle syndical français, mais qui a porté ses fruits !
En 2015, le salaire minimum des travailleur·ses de Los Angeles a doublé, passant de 7,25$ par heure à 15 $ de l’heure. Derrière cette victoire impressionnante se cache un impressionnant travail d’organisation collective, réalisé grâce à la campagne “Fight for Fifteen”. Lumir Lapray y a participé pendant un an, alors qu’elle était étudiante en échange en Californie. Elle nous raconte aujourd’hui les coulisses de cette campagne et nous partage ses réflexions sur sa mise en œuvre : une stratégie éloignée du modèle syndical français, mais qui a porté ses fruits !
Vous aimez nos contenus ? Pourquoi ne pas vous y abonner ?
Introduction de Sergio Maviel
« En tant que syndicaliste étudiant à Solidaires, qui se veut antiraciste, antisexiste, antifasciste et anticapitaliste, j’ai beaucoup aimé une question qui est posée en filigrane de cet entretien : à quel point une lutte syndicale peut-elle être pragmatique ? La force de Fight for Fifteen a été de se concentrer sur un message unique et clair (obtenir 15 dollars par heure), et de mobiliser un maximum de personnes autour de cette revendication. Les questions idéologiques, de prise en compte des discriminations sexistes et racistes, ou les questions portant sur les types d’alliance politique étaient alors secondaires. De mon point de vue, ce choix a de quoi étonner ! Et ce témoignage, en illustrant dans les détails les formes que peut prendre le pragmatisme, a le mérite d’inviter à une réflexion profonde sur nos postures de principe, leur pertinence et leur efficacité dans la lutte collective. C’est aussi un témoignage qui livre des détails très précis sur les rôles joués par les organisatrices de terrain, les liens qu’elles ont dû tisser avec leur base, et avec leurs financeurs, et les manières dont elles ont convaincu les élus (avec tous les sacrifices que cela a pu demander). Les réflexions de Lumir, qui compare le contexte étatsunien au contexte français, rendent ce témoignage d’autant plus fort et utile ! »
Bonjour Lumir, et merci d’avoir accepté de réaliser cet entretien ! Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de toi et nous expliquer comment tu t’es retrouvée à militer dans la campagne “Fight for 15” ?
Bonjour ! Alors pour moi l’aventure a commencé en 2014. A l’époque, je venais de finir ma 4e année de Sciences Po Lyon, où je m’étais spécialisée en sociologie. J’avais 21 ans et, pour ma seconde année Master, j’ai eu la possibilité d’étudier aux États-Unis, à l’université de Los Angeles. En Septembre, j’ai commencé à essayer de trouver un terrain de recherche pour mon travail en sociologie de l’immigration. C’était un peu complexe parce que je ne voulais pas être juste « observatrice ». Ce qui m’intéressait en particulier, c’était d’étudier la façon dont des groupes, qui au départ étaient en position de faiblesse, avaient pu s’organiser et créer des rapports de force. Après quelques semaines à explorer certaines pistes, j’ai découvert qu’un de mes profs de socio était membre du « Labor Center » de UCLA (University of California, Los Angeles), et qu’il s’était spécialisé dans l’histoire des luttes syndicales. De fil en aiguille, j’ai alors été mise en contact avec Rose-Marie (que tout le monde appelait Rosa), une militante syndicale qui recherchait une stagiaire pour l’aider sur une nouvelle campagne, dédiée la hausse du salaire minimum : « Raise the Wage » (la déclinaison locale de la campagne nationale « Fight for Fifteen »).

« Fight for 15 », c’est quoi ?
Ce mouvement syndical étatsunnien plaide pour que le salaire minimum soit doublé, et porté à 15 $ de l’heure (alors qu’il est à 7,25 $ par heure en 2009). Or en Californie, du fait des forts coûts des loyers, pour vivre dignement, il faudrait gagner au moins 32 $ par heure. Le mouvement a débuté en 2012, et a connu des succès aux niveaux national et local, notamment en Californie, entre 2014 et 2021. Il a impliqué plus de 17 millions de travailleurs. Au niveau fédéral, la revendication des 15 $ a gagné en popularité auprès des démocrates ces dernières années. En 2019, la Chambre des représentants a adopté la loi « Raise the Wage », mais le Sénat, alors contrôlé par les républicains, l’a rejetée. En janvier 2021, le projet a été introduit à nouveau au Sénat, à présent sous contrôle des démocrates.
« Fight for Fifteen », c’est un slogan ambitieux ! Est-ce que tu sais comment est née cette revendication des 15 dollars ?
C’était un moment où la coalition syndicale Wage Theft (« vol de salaire ») était en recherche de leur prochaine grosse campagne. Ils avaient mené une campagne nommée « Clean Car Wash » à Los Angeles, pendant laquelle ils avaient lutté contre la pratique du vol de salaire (quand les patrons refusent de payer leurs employé·e·s) et les licenciements abusifs dans les secteurs du nettoyage des voitures, des hôtels et du secteur textile dans le quartier coréen. La coalition avait en particulier lancé une série de procès collectifs (« class actions ») et ils en avaient gagné 85%. Cette victoire n’avait pas été simple ni totale, mais elle avait permis à un petit groupe de militant·e·s qui travaillaient vraiment sans grands moyens financiers (avec des personnes sans-papiers et des communautés difficiles à syndiquer), de rencontrer d’autres gens avec d’autres problèmes. Et je crois que c’est là qu’a émergé l’enjeu des 15 dollars. Mais il a encore fallu du temps avant ça devienne une vraie revendication. Quand je suis arrivée, ça faisait déjà 5 ans que des personnes de la coalition Wage Theft galéraient à mettre le sujet de l’augmentation du salaire minimum sur la table. D’ailleurs, le travail de fond pour amener ce sujet avait surtout été fait par des femmes, latinas, dont certaines sans papiers. Des gens qui n’étaient pas privilégié·es.
Comme cet enjeu allait toucher tout le monde, les organisatrices de terrain ont vite compris qu’ils devaient ratisser plus large et se servir des grosses confédérations syndicales comme AFL-CIO1 qui ont beaucoup de membres, beaucoup d’argent, et sont visibles auprès des élus. C’était un changement d’ampleur, effrayant pour les hommes et femmes politiques. En effet, comme la Californie est très ségréguée socialement, certains districts sont entièrement peuplés d’employé·es, d’autres d’employeur·ses. Donc pour certain·es élu·es, justifier le doublement du salaire minimum auprès de leur district était beaucoup plus difficile que pour d’autres. A l’époque, même les travailleur·ses pouvaient trouver délirante l’idée de doubler le salaire minimum !
Avec un tel objectif, ça n’a pas dû être facile de se mettre d’accord sur des revendications précises.
Effectivement, chaque revendication a fait l’objet de nombreux débats. Par exemple, les dates de mise en application. Le mot d’ordre de Rosa, qui n’était pas compris par tout le monde, c’était « pas d’exceptions » : on double le salaire minimum de tout le monde à Los Angeles. Cela impliquait alors de faire des concessions sur le calendrier de l’application de cette mesure. Après négociations, il avait été décidé que le doublement des salaires aurait lieu en 2020 pour les entreprises de plus de 1000 salarié·es, puis en 2021/2022 pour les petits commerces et les associations. A noter que ces dernières n’étaient pas du tout des alliées : elles essayaient de négocier sous prétexte que leur action était charitable. Cette négociation sur les dates a pris des mois… On a aussi débattu sur le nombre de jours de congé maladie, avant de se mettre d’accord sur 5. Et notre revendication principale est devenue « $15 and 5 days of paid sick leave ». Au niveau national, il y avait aussi une revendication sur les licenciements abusifs visant les personnes syndiquées : « the right to form a union » (le droit d’être syndiqué). On l’a inclus dans nos discours pour soutenir le mouvement national et rester cohérent·e·s, mais le cœur de notre message restait bien « $15 and 5 days of paid sick leave ».
Le syndicalisme n’est pas un droit aux États-Unis ?
Non, en effet. Contrairement à ce qu’on connaît en France, aux États-Unis le syndicalisme n’est pas un droit protégé. Les travailleur·ses ne peuvent pas s’organiser sur leur lieu de travail, et c’est pour ça que l’organisation syndicale se fait plutôt de façon transversale, par industrie (par exemple le textile). Le statut de syndiqué est gardé secret, aussi car il y a beaucoup de travailleur·ses sans papiers, ou journaliers. Tu peux être viré·e si on apprend que tu es syndiqué·e…
Pour parler de ce travail d’organisation syndicale, est-ce qu’on peut parler de union organizing ? Et si oui, tu le définirais comment ?
Disons que le union organizing c’est avant tout du community organizing (de l’organisation collective) avec un thème, qui est le travail. Je pense que les organisatrices que j’ai pu rencontrer ont choisi d’appliquer ces techniques au monde du travail car aux Etats-Unis, si tu ne travailles pas tu n’existes pas. C’est un endroit où il y a de masses de gens qui vivent sans filet de sécurité.
Pour la campagne Fight for 15 à Los Angeles, le premier travail d’organisation a d’abord été de rassembler toute une coalition syndicale derrière une même revendication, avec un comité de pilotage commun et des organisatrices salariées (et issues de la base) pour animer la campagne au quotidien. Et puis ensuite s’est posée la question de la stratégie.
Au niveau national, la stratégie de Fight For Fifteen, c’est le “tipping point” (le point de bascule) : dans un Etat fédéral, tu cherches à faire passer des lois combinant géographie et industrie. Ainsi, plutôt que de s’attaquer à toute la Californie, l’idée était de choisir une ville-clé (Los Angeles, qui est la ville comptant le plus de travailleur·ses pauvres du pays) et des industries symboliques (par exemple, l’industrie des fast-foods avec McDonald’s). C’est comme les dominos : l’idée est que si une industrie-clé tombe, alors le reste va tomber.

Qui étaient les membres de la coalition Fight For Fifteen à Los Angeles ?
La coalition était dirigée par un comité de pilotage assez hétérogène.
Tout d’abord, il y avait les représentants de la confédération syndicale AFL-CIO, qui apportaient beaucoup de ressources. C’était eux qui mettaient à disposition des locaux, des délégué·es syndicaux, et des fonds pour payer des organisatrices de terrain.
Ensuite, comme aux Etats-Unis tout est organisé par communautés, il y avait des représentants d’organisations communautaires. Par exemple, il y avait un rabbin de Jewish Family Alliance for a Better-world qui était très présent et qui relayait à ses congrégations, tous les samedis, la bonne parole du « 15 dollars par heure ». Il y avait aussi des membres de KIWA (Koreatown Immigrant Workers Alliance)2
Sur le terrain, il y avait aussi les organisateur·rices professionnel·le·s, dont Rosa était l’une des coordinatrices. D’une part on avait des organisateur·ices mis à disposition par les syndicats pour faire le lien sur le terrain et mobiliser dans leurs propres secteurs (ceux-là avaient plutôt le même profil sociologique que les délégués d’AFL-CIO). Et d’autres part on avait des organisateur·ices issu·e·s des coalitions militantes (comme la campagne Wage Theft), qui étaient plutôt des femmes, racisées, issues de l’immigration et particulièrement actives sur le terrain.
Enfin, au plus près des travailleurs·euses, il y avait tous les militant·e·s syndicaux·ales bénévoles de la base. C’est pour cela que je fais une distinction entre militant·e·s grassroots et organizers. Les militant·e·s grassroots, ce sont les travailleurs·euses qui, au quotidien et bénévolement, organisent leurs collègues dans le secteur où iels travaillent. Tandis que les organizers ce sont celleux dont c’est le métier d’organiser les travailleurs·euses, et qui sont rémunéré·es pour faire ça. A « Fight for 15 », les grassroots n’avaient pas accès aux réunions mais étaient en lien avec les organizers. Par exemple, Rosa, organizer, connaissait tout le monde et faisait passer les informations. C’est comme ça que des personnes qui au départ n’étaient pas concernées par la campagne étaient quand même présentes à tous les événements. Rosa avait déjà travaillé avec elleux. Souvent c’était des mères de gens qui travaillaient au car wash. Certaines personnes étaient porte-paroles, d’autres mobilisaient (ils allaient chercher leurs sœurs, cousins, voisines), d’autres participaient à des actions, prêtaient leur voiture, s’occupaient de la nourriture, des affiches…
A quel point était visible la différence sociologique entre délégués syndicaux et organisatrices ?
Les deux étaient clairement distinct·es : les délégués étaient très privilégiés, c’était des hommes, blancs, plus vieux, très centrés sur leur branche, franchement sexistes et racistes, et souvent paternalistes dans les débats (« I must ! », « I know ! »)… Au contraire, les organisatrices étaient des femmes, jeunes (moins de 30 ans), issues du prolétariat, latinas, de la première génération à obtenir des papiers et à aller à l’université. C’étaient des trans-classes, et souvent les seules dans leur famille à ramener de l’argent. Beaucoup avaient leurs frères en prison, morts, ou bien en emploi très précaire. Elles avaient eu d’énormes responsabilités très tôt dans leur vie et étaient très habituées à devoir s’occuper de beaucoup de personnes à la fois. Malgré ça elles avaient toutes fait de très bonnes études, en bossant parallèlement dans des emplois précaires. Elles avaient toutes travaillé sur leur campus pendant les études, notamment avec des travailleur.euses sans papier (service dans les cantines, ménage, plonge, etc), et elles avaient toutes commencé à faire du syndicalisme dans ce cadre-là.
De fait, elles avaient un vrai attachement à leur base puisqu’elles en faisaient vraiment partie, et qu’il n’y avait pas de frontière entre leur engagement et leur quotidien. Ça posait parfois problème au niveau de l’affect, elles avaient du mal à poser des limites. Rosa était par exemple constamment en train d’héberger des gens, en parallèle d’une multitude d’activités, c’était invivable pour elle. D’ailleurs, je l’ai revue six mois après la campagne, et elle avait fait un burnout, elle était en arrêt de travail.
Comment les organisatrices avaient-elles été formées ?
A l’université, elles avaient pris des cours théoriques sur l’organizing, puis elles avaient suivi des camps d’été, organisés par AFL-CIO sur six semaines. Ensuite elles avaient appris sur le tas, mais en étant payées, avec des mentors, un·e chef·fe, un·e manager, une structure : c’était un métier, elles n’apprenaient pas seules.

Une si grande coalition, j’imagine que ça ne se faisait pas sans tensions ?
C’est sûr… Par exemple, pendant les réunions les délégués syndicaux prenaient la parole tout le temps pour ne rien dire d’intéressant et, au moment de distribuer le travail, c’était les organisatrices qui prenaient tout. Rosa était très en colère. Il y avait des frustrations. Mais les organisatrices étaient assez pragmatiques pour voir qu’elles avaient besoin des délégués syndicaux pour gagner, parce qu’ils étaient riches, nombreux et blancs. Régulièrement elles se rappelaient les unes les autres : « l’important c’est qu’on gagne, je sais que tu as raison, mais on sait aussi qu’on a besoin d’eux donc on respire et on repart ».
Comme les délégués syndicaux étaient la source des financements, la question se posait de savoir jusqu’où ils étaient décisionnaires. Mais les gros rapports de force se jouaient aussi sur le nombre, et Rosa pouvait ramener beaucoup de monde pendant les mobilisations pour leur mettre la pression.
Je me rappelle aussi d’une fois où j’avais organisé une levée de fond et une collecte de produits d’hygiène féminine pour un refuge, et j’avais besoin d’imprimer des flyers. On était allées à la AFL-CIO et j’ai demandé à Rosa si je pouvais imprimer. Elle m’avait dit : « dans la vie il ne faut jamais demander, tu fais et après tu vois ce qu’on te dit et si on te gronde tu souris, tu t’excuses et tu dis que tu ne recommenceras pas, tu prouves que ce n’est pas grave, que tu as bien fait même ». C’était vraiment comme ça qu’elle fonctionnait.
Cet article de l'Université Populaire des Luttes
Comment arrivaient-elles à s’imposer en tant que femmes non blanches ?
Sur cette question des stratégies pour s’imposer face aux hommes, je ferais une distinction générationnelle.
Aujourd’hui les femmes âgées qui ont émigré de leur vivant à Los Angeles viennent de pays qui ont des traditions de socialisme. Elles puisent leur légitimité auprès de leur famille, elles interviennent en tant que mères ou en tant que « femmes de » – c’est quand même des milieux conservateurs très croyants, il ne faut pas prendre le travail des maris, surtout dans un milieu où le travail est rare. Ce qui est assez intéressant c’est qu’elles se servent de cette identité de mère pour ramener d’autres enjeux liés aux 15 dollars. Par exemple, dans la coalition « Fight for 15 », une femme qui venait du Venezuela avait créé une alliance des mères contre le « poverty draft » (l’engagement militaire des jeunes pauvres, qui le font soit pour avoir des papiers, soit pour pouvoir aller à l’université gratuitement). Un jour elle avait raconté que si son fils avait été payé 15 dollars de l’heure, il n’aurait pas été embarqué par l’armée, il ne serait pas revenu avec un SSPT3, il n’aurait pas commencé à frapper sa femme et du coup sa femme et ses trois enfants n’auraient pas été obligés de venir vivre chez elle. Malgré leur milieu conservateur, ces femmes-là parviennent à trouver des lieux d’engagement dans des espaces beaucoup plus larges que la maison ou le lieu de travail. Et ça fonctionne, les maris ne les embêtent pas…
De leur côté, les femmes jeunes mettent en avant leur non-blanchité. Elles sont toutes bilingues, et elles ne manquent à aucun moment de le rappeler ou d’interagir en espagnol avec leurs membres devant les membres du AFL-CIO qui ne comprennent rien, pour rappeler que sans elles il n’y a pas d’interaction avec la base. Elles jouent sur le nombre : la moitié des habitant·es de Los Angeles sont latino·as, et des travailleur·ses pauvres. Elles montrent plus qu’elles ne disent. L’idée est de se rendre nécessaires par la quantité de travail qu’elles fournissent. Ça prend énormément de temps et d’énergie et elles ne sont pas dupes. Au fond elles savent qu’on ne les respecte que sous cette condition. Elles sont très solidaires aussi, ce qui va un peu à l’encontre de ce qu’on voit souvent quand les femmes prennent du pouvoir, où elles entrent en compétition face au nombre restreint d’opportunités qui s’offrent à elles. Là, l’objectif est vraiment de faire grossir les rangs de personnes comme elles, car plus elles seront nombreuses et moins on pourra les mettre dehors.
Est-ce que ces questions d’identité avaient un impact sur la stratégie de la coalition ?
Je dirais qu’on peut s’organiser autour d’un “problème” ou autour d’une “identité”. Et dans cette campagne, j’ai pu observer que mettre en avant des enjeux liés à l’identité rend difficile la création de coalitions larges. De manière générale il y avait assez peu de tolérance pour les gens qui choisissaient un discours identitaire dans une lutte syndicale. Par exemple, des personnes noires de la coalition avaient voulu mener une lutte identitaire, en demandant que les revendications portent sur la discrimination à l’emploi sur des critères raciaux, et elles ont été rejetées parce que ça ne concernait pas tout le monde. De même, c’était très mal vu de ne parler qu’en tant que mexicaine ou latina. Rosa et les autres s’en servaient au besoin, mais n’en faisait pas le centre de leur lutte. La coalition était d’avantage organisée autour du “problème” (les 15 dollars) qui concernait tout le monde, ce qui faisait que les questions d’identité n’étaient finalement qu’un moyen circonstanciel.
Avec un tel pragmatisme, on est loin du modèle français !
Oui complètement. Parce que tandis qu’en France le communautarisme est vu comme séparatiste, là-bas c’est la base de toute coalition. Mais ça révèle aussi les inégalités entre communautés, et les luttes de pouvoirs qui les opposent. Pour reprendre l’exemple des revendications des personnes noir·es sur la discrimination à l’emploi, le rejet de leur proposition peut s’expliquer par le fait que la communauté afro-états-unienne est plus délitée que la communauté latino, notamment parce que leurs liens familiaux et communautaires sont moins forts. Par pragmatisme, Rosa voulait que la coalition porte UN message unique, sans revendications particulières pour les différentes communautés. Parce qu’elle savait que si le message ne rassemblait pas tout le monde, leur combat serait perdu d’avance. Dans ce contexte, comme la communauté noire ne mobilisait pas assez pour pouvoir imposer son propre agenda face à la communauté latina, le pouvoir était clairement du côté de Rosa. Or, dans sa stratégie, seul le nombre de personnes mobilisables comptait, tandis que les enjeux systémiques qui expliquaient qu’une communauté soit plus ou moins en capacité de mobiliser n’étaient pas pris en compte.
Ce pragmatisme pouvait parfois être un avantage car la coalition n’était pas vue comme menaçante, politiquement parlant. Cette campagne avait un objectif précis. Et il était clair que le jour où les personnes mobilisées obtiendraient gain de cause, elles s’en contenteraient. Du coup l’identité idéologique des soutiens de la coalition avait moins d’importance que la construction du rapport de force. Pas de discours anticapitaliste contre Wal-Mart, ce n’était pas le sujet. D’un certain point de vue, ce pragmatisme paye, parce que quand ton salaire passe de 7 à 15 dollars, alors ton problème est résolu. Toutefois, je pense que ce pragmatisme apolitique est en train de changer. La vie politique étatsunienne est en pleine polarisation depuis l’élection de Trump, en particulier à cause des questions d’immigration. Les familles latinas sont maintenant impactées par des dispositifs fédéraux du pays (notamment le ICE4 et les déportations5).

Que se passait-il concrètement pendant vos réunions ?
Le premier point à l’ordre du jour était toujours : “Où en est-on des flashcards ?”. En effet, pour la manifestation du “May day” 6, qui était l’évènement phare de la campagne, on devait avoir réuni au moins 100 000 cartes qu’on avait fait signer à tout le monde avec écrit : “Je soutiens Fight for 15, mon nom est X, je travaille à Y”. Rosa vérifiait et mettait la pression, ensuite on échangeait nos stratégies pour faire signer, on devait faire signer tout le monde, la base, les chercheurs, l’opposition, les patrons, les politiques.
Ensuite on résumait les rencontres de la semaine : “je suis allée voir X avec Y, il a dit oui / non / il ne sait pas, il faut qu’on revienne avec telle documentation, qui s’en charge ?”.
Ensuite on travaillait sur le message et les médias. Notamment le choix des revendications.
Puis à la fin on se répartissait les tâches de la semaine.
Quelles étaient vos différentes tactiques ? Tu as parlé des cartes, des rencontres…
Le premier axe c’était la recherche. Par exemple, il a fallu travailler sur des questions d’économie pour contredire un argument phare de nos opposants : le risque des faillites avec l’augmentation des salaires. Ensuite, il y avait le lobbying auprès des membres du conseil municipal, mais aussi des associations, des patrons… On a vu tout le monde, y compris des gens qui nous détestaient. On leur disait : “on comprend votre problème mais voilà notre problème à nous”. Après on a fait quelques actions, par exemple des occupations dans l’espace public, qui visaient surtout à faire de la sensibilisation. Les gens voyaient qu’on était là, on donnait des tracts, quelqu’un criait nos revendications, et on s’en allait toujours rapidement, après une heure ou deux. On sait que les personnes ont du travail, elles sont harassées par leurs dettes, donc on évitait le blocage. Il y avait aussi une campagne en ligne. Rosa disait que chaque geste aidait, chaque retweet, chaque détail. Deux femmes qui n’avaient rien demandé sont reparties avec des stickers à coller sur leurs boîtes aux lettres. Les étatsunien·nes utilisent aussi beaucoup la lettre pré-écrite que tu envoies à ta/ton conseiller municipal. On faisait des petites interviews des gens, beaucoup de relations média, locaux surtout (les nationaux c’était plutôt pour quand on aurait gagné). En local on présentait les victoires du passé, des portraits de travailleurs·ses etc. On mettait beaucoup en avant quelques patron·nes allié·es. On a fait quelques conférences de presse, pour témoigner et apporter un peu de recherche. Et puis il y avait les marches : May Day était LE gros évènement.
As-tu des anecdotes significatives où tu t’es rendu compte d’à quel point être organisatrice était un métier ?
Oui, quand on a prévu notre première réunion de lobbying. Il s’agissait d’aller voir les différent·es membres du conseil municipal pour savoir si on pouvait compter sur leurs votes. C’était des gens qui n’avaient pas le temps. Du coup on pouvait juste partager quelques informations, une anecdote et un appel à l’action (voter !). On y allait toujours avec un groupe de 5 ou 6 personnes, qui racontaient leur histoire, pourquoi cette campagne était importante, où elles habitaient, votaient… Ces personnes disaient souvent “j’ai voté pour vous”, même quand ce n’était pas le cas, et remerciaient toujours leur interlocuteur de manière très polie.
Pour préparer ça, on avait utilisé un outil : “la carte du pouvoir”. J’étais hyper impressionnée, je n’avais jamais vu ça. On avait fait la liste de tou·tes les membres du conseil municipal de Los Angeles, on les aavit placés sur la carte du pouvoir et on avait fait une liste de tout ce qu’on savait sur eux/elles, les moindres détails jusqu’à « aime les chiens », leur personnalité, leurs faiblesses, leur passé. Rosa savait tout sur tout le monde. A partir de là, elle prévoyait son plan de bataille : on va parler à telle personne pour telle raison, c’est ça son sujet, donc on va dire ça, on va amener telle et telle personne avec nous. A chaque fois il y avait une personne différente qui racontait un aspect différent de ce que ça changerait dans sa vie d’être payé 15 dollars de l’heure. Comme Rosa connaissait très bien tout le monde, elle changeait l’ordre des témoignages suivant la personne qu’on rencontrait, et ça fonctionnait à chaque fois.
A ce moment-là j’ai réalisé qu’il y a des outils, des stratégies, des formations, tu ne vas pas à une réunion avec une personnalité politique comme ça. C’est deux semaines de réflexion pour peut-être dix minutes de rencontre. Tout compte : comment tu t’habilles, qui tu amènes, comment tu les prépares, pendant une demi-heure tu les formes dans la voiture, tu leur expliques comment répondre à une question… En fait, rien n’est laissé au hasard. Une fois une femme racontait que son fils souffrait d’un SSPT dans le bureau d’un vétéran, je me suis dit « Waow ! ça tombe trop bien » et Rosa m’a dit « Non jamais rien ne tombe trop bien ».
Il y avait toujours des plans de secours pour anticiper chaque scénario. Les témoins étaient préparé·es, s’il y avait la presse ils savaient ce qu’ils devaient dire, ou à qui s’adresser s’ils/elles ne pouvaient pas répondre. Comme ces personnes étaient entraînées, elles se sentaient très valorisées. Quand on les envoyait parler aux journalistes elles étaient super heureuses, et ça marchait !
L’enjeu était de montrer aux élus qu’il n’était plus possible de fermer les yeux, qu’il fallait forcément faire passer le salaire minimum à 15 dollars de l’heure. Mais on devait aussi leur montrer comment faire la transition tranquillement, sans qu’ils aient l’impression d’y perdre. Par exemple on leur demandait de quoi ils avaient besoin pour se faire réélire7.
Tout était très documenté aussi. A un moment, par exemple, un conseiller municipal a essayé de négocier pour 12 dollars de l’heure. Rachel lui a montré des calculs qui expliquaient qu’avec 12 dollars on pouvait acheter tant de packs de lait, qu’avec 12 dollars dans tel quartier il y avait tant de chance que ton enfant soit dans une école avec de l’amiante, etc. Tout était justifié et exposé de manière claire.
On avait aussi des stickers, et de la peinture pour écrire “15” sur les joues de tout le monde. Ça semble être un détail, mais quand des centaines de gens viennent, ça représente de la logistique : les drapeaux, les tee-shirts pour tout le monde, et à chaque fois des bus entiers, des dizaines et des dizaines de gens. Il fallait qu’on s’assure que toutes les places assises étaient prises et qu’on était debout, qu’on ne pouvait plus rentrer.
Y avait-il de la théorie ou était-ce seulement du terrain ?
On découvrait les outils et on les utilisait. Rosa joignait toujours l’acte et la parole, elle formait des gens en permanence. D’ailleurs, elle avait toujours au moins trois stagiaires. En revanche, ça s’inscrivait plus dans de l’intuition qu’une théorie du changement. Cette intuition venait de la connaissance qu’elle avait de sa base. Par exemple, elle savait qu’une liste mail ne servait à rien puisque les gens n’avaient pas d’ordinateur, donc on elle avait une liste de numéros et elle envoyait des messages aux gens tous les mois, sachant qu’ils jetaient les téléphones souvent car ce n’était pas des smartphones. Certains se faisaient déporter, d’autres arrivaient, et il fallait renouveler la liste de numéros en permanence. Les effectifs de la base changeaient tout le temps.
Il n’y avait pas non plus d’expérimentation, et pour chaque chose mise en place on était sûres de son efficacité. Les organisatrices opéraient sur des temps très réduits (la campagne Fight for 15 à Los Angeles a duré seulement 1 an) donc on ne pouvait pas se permettre de faire des choses sans savoir si ça allait fonctionner.

Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi a consisté ce fameux rassemblement du May day ?
La marche de May day fut incroyable. On l’a vraiment organisé pendant des mois. On ne faisait jamais de manifestations, donc cet évènement a été l’un des seuls où l’on a pu avoir une visibilité de masse. L’enjeu, c’était le nombre. Et le jour venu, on était des milliers. On a commencé par déverser les 100 000 cartes dans des outils du quotidiens (des brouettes, des paniers à linge…) sur le parvis de la mairie de Los Angeles, puis on a fait une conférence de presse où on a redit pourquoi on voulait ça, en quoi c’était important. Tout le monde portait des tee-shirts, des pancartes, et il y avait même des mariachis qui jouaient de la musique mexicaine traditionnelle. Il y avait des gamins, des vieux et des vieilles, c’était vraiment super. On a fait un parcours où on s’est arrêté·e·s devant le centre de détention qui regroupait les personnes sans papiers arrêtées qui allaient être renvoyées dans leur pays d’origine. Tous les détenus tapaient contre les fenêtres avec leurs gamelles, et tout le monde pleurait. On a fait une minute de silence en leur mémoire, et quelqu’un a récité une prière. Une organisatrice d’un autre mouvement a fait un discours assez engagé, anti-gouvernement. On n’a pas bloqué la circulation mais on a stationné à des endroits où les gens pouvaient nous voir : ponts, trottoirs, avec nos pancartes, assis, le poing levé. Les gens nous voyaient mais on ne les embêtait pas. Il y avait régulièrement des discours, une fanfare assez classique, jusqu’au moment merveilleux où on est arrivés dans un parc. Là, il y avait une ressourcerie avec plein de nourriture, des dentistes qui faisaient des consultations en plein air, des médecins qui faisaient des palpations de seins pour prévenir les cancers, des avocat·e·s spécialisé·e·s dans l’immigration, des traducteurs·trices, des artistes pour les enfants qui faisaient des maquillages… C’était un super moment, la marche a duré une heure et après on a passé quatre heures dans le parc à rigoler, à manger des barbapapas. J’en garde un super souvenir. On était content·es, à la fin on s’est vraiment dit qu’on avait fait du bon travail. Mine de rien ça motive les gens de leur dire “dentiste gratuit” dans un pays où tu paies 500 euros pour aller chez le médecin ; puis les artistes avaient de super belles affiches, je crois que ça a joué un rôle non négligeable.
Après on a mené d’autres évènements, mais plus discrets. On a eu un gros gala fin mai avec tout le gratin syndicaliste du pays ; je crois que c’était 1500 dollars la place pour venir s’asseoir, 10 000 dollars la table. Il y avait les membres du conseil municipal, les grands patrons, assez sympathiques dans l’ensemble puisque l’objectif était de lever des fonds pour Fight for 15, donc ce n’était pas n’importe qui : des grands pontes, beaucoup de gens de l’État, des super stars syndicalistes, des élus démocrates… C’était un peu le dernier coup de force, et après on a gagné.

Est-ce que ça a changé ton image du syndicalisme ?
Oui. Honnêtement, avant je voyais ça comme quelque chose de dépassé, qui avait eu son heure de gloire, dont je ne me sentais absolument pas concernée. J’avais l’impression que ce n’était pas des gens qui voulaient vraiment gagner et je n’y voyais pas de place pour moi. Quand je suis arrivée à Fight for 15, j’ai halluciné, parce qu’il y avait des femmes, qui avaient mon âge, racisées, certaines avaient fait Berkley ou un type d’études similaire au mien, elles étaient payées, pas grassement mais c’était un travail. C’est ça qui m’a surprise : le sérieux. C’était un travail, et le plus sérieux de tous parce qu’on avait dans les mains le futur de gens qui n’avaient pas les moyens de se défendre eux-mêmes.
La gloire, à la fin, est allée plutôt aux grosses centrales syndicales ?
J’ai l’impression que tout le monde s’en est un peu sorti quand même. Par exemple, sur la première page du New-York Times, c’est Rosa qui figure avec des travailleurs·euses. J’ai l’impression que tout le monde a tiré son épingle du jeu. Et puis la base, elle, sait à qui elle doit sa victoire.
De l’extérieur, ça peut sembler être une campagne comme une autre, sauf que vous aviez une revendication démesurée ! Qu’est-ce qui fait que vous avez gagné ?
Il y a déjà le nombre, c’est central : on était partout, tout le temps, tu ne pouvais pas te tourner et ne pas nous voir, vraiment. Et puis c’était mûr, il y avait eu des victoires antérieures, les gens connaissaient Rosa, ils savaient qu’il ne fallait pas la chercher au vu du nombre de gens qu’elle pouvait ramener. Elle pouvait changer le cours d’une élection. L’espoir et la motivation étaient présents. La coalition était juste faramineuse. Bien sûr il y a aussi un contexte plus large : on commençait à entendre parler du sujet ailleurs aux Etats-Unis. Face à tellement d’histoires intenses, de tellement de personnes présentes, ça aurait été impossible de ne pas voter en faveur de cette mesure. Il y avait des pancartes partout, des panneaux, presque tous les travailleur·ses étaient dans le mouvement, c’était devenu une campagne incontournable.
Il y a aussi cette culture du rêve états-unien : les personnes veulent du rêve, si tu leur vends du rêve elles sont avec toi. Et avec de la bienveillance, elles te suivent, croient en la force collective. Je ne sais pas s’il y a la même énergie en France. Je me trompe peut-être mais il y a une question démographique : ce ne sont pas des jeunes millennials, ces personnes ont leur travail, sont installé·es, tu leur donne une mission et elles la font, elles ne sont pas sur-sollicitées en permanence. Certes les obstacles matériels à la mobilisation sont de taille – par exemple quand les personnes ne viennent pas, ça peut être car leur sœur a été déportée ou quelque chose de cet ordre. Cependant quand tu as des enfants, que c’est ta ville, etc, tu t’engages plus. Je pense d’ailleurs que c’est un peu la limite de la politique identitaire : ton identité ne t’ancre pas quelque part au quotidien. Dès que tu parles d’un problème spécifique ça marche mieux – surtout quand le problème en question concerne une augmentation de salaire. C’est une vraie question en termes de rhétorique et de radicalité. Fight for 15 d’après ce que j’en ai vu n’était pas un mouvement radical : la revendication était de taille, mais les gens ne voulaient pas changer l’ordre établi, ils voulaient juste manger, ils ne se battaient pas en agitant des concepts.
Je pense aussi que le pragmatisme est central : les personnes sont vraiment déterminées et mettent les moyens nécessaires, ils payent concrètement, ils se donnent le temps, ils le traitent comme quelque chose de sérieux. Et ces personnes ne sont jamais agressives, malgré la violence quotidienne. Elles arrivent à rester concentrées sur le long terme, et ne se laissent pas bouffer par la violence de la société et les difficultés internes. En fait, les gens ont conscience que si on s’embrouille on est morts, donc ça n’est pas personnel, il n’y a pas d’affect. C’est un vrai travail. Et ils/elles finissent par gagner.

En savoir plus sur l'auteur·ice
VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE
ET VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN ?
On a bien réfléchi et on vous propose de lire celui-ci, qui est très complémentaire.
L'Université Populaire des Luttes
Traduire, rechercher, mettre en page et faire vivre notre communauté de bénévoles permet de garder en mémoire les récits de luttes, sources inépuisables d’espoirs et d’inspirations tactiques et stratégiques.
Dans un système politique prédateur dont l’un des objectifs est de nous priver de nos repères militants historiques, les moyens de financer ce travail de mémoire sont rares.
Pour nous aider à garder cette université populaire des luttes accessible gratuitement et contribuer à renforcer nos luttes et nos solidarités, faites un don !