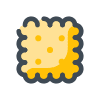Explorer l’imaginaire du community organizing avec un praticien États-unnien
 Vétéran de l’organizing, Dave Beckwith a marché avec Martin Luther King, milité à Cuba, et même manifesté contre Alinsky ! Il a consacré sa vie à l’organisation collective et, après des décennies de pratique, a choisi de partager les trucs et astuces des organizers dans une pépite : le « Guide du routard du community organizing ». L’entretien ci-dessous, à lire en miroir avec l’ouvrage de Dave, permet de situer son propos. Il nous y parle de son travail quotidien d’organisateur aux Etats-Unis, de ses surprises, ses victoires mais aussi ses questionnements.
Vétéran de l’organizing, Dave Beckwith a marché avec Martin Luther King, milité à Cuba, et même manifesté contre Alinsky ! Il a consacré sa vie à l’organisation collective et, après des décennies de pratique, a choisi de partager les trucs et astuces des organizers dans une pépite : le « Guide du routard du community organizing ». L’entretien ci-dessous, à lire en miroir avec l’ouvrage de Dave, permet de situer son propos. Il nous y parle de son travail quotidien d’organisateur aux Etats-Unis, de ses surprises, ses victoires mais aussi ses questionnements.
![]() Le guide du routard du community organizing
Le guide du routard du community organizing
![]() L’interview de l’auteur
L’interview de l’auteur
Vous aimez nos contenus ? Pourquoi ne pas vous y abonner ?
Vétéran de l’organizing, Dave Beckwith a marché avec Martin Luther King, milité à Cuba, et même manifesté contre Alinsky ! Il a consacré sa vie à l’organisation collective et, après des décennies de pratique, a choisi de partager les trucs et astuces des organizers dans une pépite : le « Guide du routard du community organizing ». L’entretien ci-dessous, à lire en miroir avec l’ouvrage de Dave, permet de situer son propos. Il nous y parle de son travail quotidien d’organisateur aux Etats-Unis, de ses surprises, ses victoires mais aussi ses questionnements.
![]() Le guide du routard du community organizing
Le guide du routard du community organizing
![]() L’interview de l’auteur
L’interview de l’auteur
Quand as-tu entendu parler du community organizing pour la première fois ?
Et bien, en fait, mon père était pasteur dans l’église baptiste américaine. Il a joué un rôle actif dans le mouvement des droits civiques et dans les mouvements liés à la justice sociale au début des années 60. Et quand j’avais 13 ans, le Dr Martin Luther King est venu à Boston pour une Marche qui faisait partie de la lutte pour le Voting Rights Act. Mon père m’a emmené avec lui et nous avons participé aux formations pour l’organisation de la Marche. Et c’est là que j’ai vu qu’un tel événement, ça se prépare. Ce n’était pas du tout spontané. Au contraire, l’événement lui-même n’était qu’une partie d’une stratégie à plus long terme. C’est là que j’ai compris que je voulais participer à ce travail de fond : je ne voulais pas me contenter de marcher, mais bel et bien faire partie de celles et ceux qui organisaient la Marche.


Crédit photo : Dave Beckwith
Cette visite à New York, c’était en quelle année ?
Ça devait être 1967.
Donc Alinsky était encore en vie !
Oh, oui. Je l’ai vu une fois, à l’Université du Massachussetts. J’étais un membre actif du mouvement des étudiant·e·s pour une société démocratique (SDS – students for a democratic society), une organisation ancrée à gauche. J’étais dans ce monde militant déjanté et pour une raison qui m’échappe, Alinsky s’est rendu au Williams College, à 60 miles de là où je me trouvais. Les groupes du SDS de l’ouest du Massachussetts ont alors décidé que nous irions mettre le bazar lors de sa conférence parce qu’ils trouvaient qu’Alinsky n’était pas assez radical. Je ne me rappelle plus vraiment pourquoi ou comment nous avons perturbé sa venue, mais ce dont je me souviens, c’est qu’il était vraiment important pour nous de montrer que nous trouvions qu’Alinsky n’en « faisait pas assez ». Des années plus tard, j’ai réussi à obtenir une copie du dossier que le FBI avait compilé sur moi, après m’avoir un temps suivi et gardé un œil sur mes activités. Et j’ai découvert que mon engagement radical m’avait valu l’honneur d’être un « FBI certified optimist ».

Qu’est-ce que ça signifie ?
Dans mon dossier, il est indiqué que j’étais dégoûté par le SDS et la Nouvelle Gauche, parce que pour moi ces mouvements n’avaient finalement pas de véritable impact sur le monde. J’espérais qu’un autre mouvement, plus radical, amènerait de vrais changements.
Donc c’est de là que vient le terme « d’optimiste » !
Oui c’est ça. J’étais un étudiant militant pour les droits civiques et contre la guerre, et je ne suis allé à l’université que parce que c’est ce que tout le monde faisait à l’époque. Mais j’ai fini par me lasser et je suis finalement parti après quelques années. Ensuite j’ai accepté un travail dans une fabrique de rideaux à Holyoke, dans le Massachussetts. C’était un boulot ouvrier tout à fait banal, pendant lequel je réfléchissais à où allait le monde.
Comment on passe de l’université à une fabrique de rideaux ?
En fait j’ai pris une année de césure pendant ma junior year et, en 1970, j’ai rejoint les Brigades Venceremos 1pour aller à Cuba (c’est d’ailleurs à partir de ce moment-là que le FBI a commencé à s’intéresser à moi). A mon retour, je ne m’intéressais plus à la vie étudiante. Et l’université n’avait pas vraiment de sens pour moi. J’ai alors préféré chercher un boulot et c’est comme ça que j’en suis venu à travailler pour une fabrique de rideaux.

Crédit photo : Dave Beckwith
C’est là que tu as été recruté comme organisateur ?
En fait ce qui s’est passé c’est qu’un ami qui était venu à Cuba avec moi a été recruté en tant qu’organisateur. Je l’ai accompagné à son entretien d’embauche et j’ai demandé au recruteur : « A tout hasard, vous n’auriez pas un deuxième poste ? ». Le gars m’a répondu : « On n’a pas d’argent et on n’a pas de postes. Mais si tu lèves des fonds pour financer ton propre salaire, alors je peux te former et te mettre au travail. » Je me suis donc rendu à l’agence des services sociaux du quartier et je leur ai demandé de me payer une formation professionnelle pour devenir community organizer. J’ai quitté mon travail à la fabrique de rideaux et j’ai déménagé à Providence, dans le Rhode Island, pour commencer à travailler en tant qu’organisateur.2 J’étais payé seulement $50 par semaine, mais j’avais la chance de travailler avec un excellent community organizer. C’a été une année d’apprentissage vraiment intense et, peu après ça, je suis devenu directeur d’une toute nouvelle community organization qui venait d’être créée dans un autre quartier de Providence.
De quel genre d’organisation s’agissait-il ? « Grassroots » ou « Broad-based » ? 3
Au début, plutôt broad-based. Il s’agissait de ce qu’on appelait une « organisation d’organisations », dans la lignée de l’approche alinskyenne. L’idée de base était de supposer qu’il existait des associations déjà bien implantées dans le quartier et qui pouvaient éventuellement collaborer ensemble. Mais en réalité, la majorité de notre travail d’organisation relevait de la mobilisation grassroots parce que sur place les organisations n’étaient pas assez proches des gens. Donc oui, sur le papier nous avions bien des organisation d’organisations qui participaient à la vie de la coalition. Mais sur le terrain, mon travail était plutôt tourné vers la mobilisation d’individus recrutés via du porte-à-porte autour de revendications qui les affectaient personnellement, plutôt que la mobilisation plus institutionnelle. De fait, nous étions en plein milieu de l’une des cinq grandes transitions de l’histoire du community organizing.
Les cinq transitions ? Je n’ai jamais entendu parler d’une théorie comme ça !
[Rires] C’est parce que c’est moi qui l’ai inventée ! Mais je peux t’expliquer ça plus en détails si tu veux.
Avec plaisir !
Ok ! Tout d’abord, je dirais qu’il y a deux Alinsky différents. Le premier Alinsky (celui qui a organisé Back of the Yards) cherchait vraiment à construire des organisations d’organisations. Mais petit à petit, ce premier Alinsky a laissé sa place au second Alinsky. Celui-ci s’intéressait plus aux campagnes qu’aux coalitions de type broad-based. Par exemple, son travail à Rochester portait en réalité sur le Black Power.4 Donc ça, c’est la première transition vers un nouveau modèle. Ensuite, au même moment, Fred Ross Senior (qui a été ouvrier agricole, organisateur, et mentor de Cesar Chavez) a développé un autre modèle : celui des organisations de service communautaire (Community Service Organizations). Dans ce modèle, tout commence par la création d’une institution qui fournit un service à ses membres. Puis, à mesure que le temps passe, les membres sont formé·e·s à la mobilisation et deviennent une armée militante prête à l’action.5 Ça, c’est la deuxième transition. La troisième transition a été la création d’ACORN, 6 qui est passé du premier modèle alinskyen (une organisation d’organisations) à un modèle basé sur le recrutement d’individus, ce qui se rapproche beaucoup plus proche des organisations de service communautaire. La quatrième transition, le community organizing basé sur la foi, est aussi née en s’écartant du premier modèle alinskyen. Elle a conservé un modèle structurel organisationnel strict, mais qui ne regroupe désormais plus que des institutions confessionnelles. Enfin, la cinquième transition a émergé du modèle ACORN, avec une philosophie plus décentralisée : des alliances de quartier basées sur les adhésions individuelles, mais sans organisation nationale pour les coordonner. Les alliances locales s’entendent bien entre elles et peuvent contribuer à des campagnes nationales, mais elles restent complètement indépendantes. Leur proximité repose donc d’avantage sur un sentiment croissant de parenté idéologique plutôt que structurelle. C’est d’ailleurs pourquoi cette mouvance du community organizing a évolué de manière à insister beaucoup plus sur l’éducation politique. Cette cinquième transition a été permise par des organisateur·trice·s comme George Goehl (de Peoples’ Action), qui a dit : « Nous devons parler de ce en quoi nous croyons et d’où nous allons, plutôt que de parler de ce à quoi nous nous opposons et de ce que nous revendiquons ». Il s’agit d’une transformation majeure dans le champ du community organizing, surtout par rapport à l’approche très « locale » d’Alinsky. Grâce à l’éduction politique, les individus découvrent qu’il est nécessaire de changer les choses au-delà de leur propre quartier.
Quand tu étais en train de te former dans le Rhode Island, qu’est-ce qui te plaisait dans le métier d’organisateur-rice ? Qu’est-ce qui te semblait important et significatif ?
Je travaillais avec des personnes qui rencontraient de grosses difficultés. Et mon rôle était de les mettre au défi de changer les choses par eux/elles-mêmes, plutôt que de changer les choses à leur place. Et ça, c’était vraiment génial. Je dois avouer qu’à l’époque, la culture du travail dans le monde de l’organizing était complètement insoutenable. Mais c’était exactement ce que je recherchais : à la fois un métier difficile et très prenant pour lequel on enchaînait à la fois de longues soirées de travail intense, mais aussi des moments de créativité qui nous permettaient de tenir le coup. Par exemple, la plupart de nos journées se terminaient par une réunion avec des habitant·e·s. Puis, le mardi et le jeudi, lorsque ces réunions étaient finies (souvent aux alentours de 23 heures), nous revenions au bureau pour échanger entre organisateurs·trices. Les bonnes nuits, quand nous étions créatif·ve·s et que nous commencions à planifier les choses ensemble, à apprendre les un·e·s des autres ou à réfléchir à de nouvelles façons de faire, nous savions que la réunion était terminée lorsque nous entendions le chant des oiseaux et que les odeurs de pain frais commençaient à s’élever de la boulangerie du coin. J’adorais cette intensité, cette créativité, et le sentiment que nous aidions les gens à prendre la parole par eux/elles-mêmes. C’était très stimulant !
Cet article de l'Université Populaire des Luttes

Quel genre d’actions est-ce que vous organisiez ? Et quel genre de tactiques est-ce que vous pratiquiez ?
Notre horizon tactique consistait à prendre un petit morceau du centre-ville7 et à le mettre sous le nez de ceux·celles qui espéraient ne pas avoir à le voir. Par exemple, nous essayions d’obtenir plus de ressources pour l’organisation du quartier afro-américain dans lequel je travaillais. Et ça passait notamment par le fait de devenir membre de l’agence United Way, qui était une grosse association de services sociaux financée de manière institutionnelle. A la tête du comité de United Way, il y avait ce gars bienveillant dont l’entreprise était florissante. Et il était connu pour être toujours positif, généreux et sympathique. Et il vivait dans un quartier très, très huppé. Donc on a organisé des équipes de deux à quatre habitant·e·s noir·e·s de notre quartier, et nous avons commencé un sondage dans leur quartier. Tout à coup, leur quartier exclusivement blanc était plein de personnes noires faisant du porte-à-porte pour poser des questions comme : « Est-ce que vous pensez que les enfants noir·e·s pauvres méritent d’avoir une balançoire dans leur aire de jeux ? », « Est-ce que vous pensez que mon frère, qui est malade, mérite d’aller à l’hôpital ? », « Et si vous êtes d’accord avec nous, merci de participer au sondage. Voici un flyer, appelez votre voisin, George Smith, et dites-lui de financer la community organization du sud de Toledo. » Et bien après un jour ou deux, Monsieur Smith nous a appelé·e·s et nous a dit : « Parlons-en. Faisons-le. Mais arrêtez de venir ici ! ».
As-tu d’autres exemples de tactiques qui permettent aux personnes des quartiers défavorisés de gagner en visibilité ?
Oui, bien sûr. A un moment donné, nous avions des problèmes de circulation. Tous les quartiers ont des problèmes de circulation : les jeunes traversent la route, et il vous faut des feux de circulation. C’est un exercice d’organisation typique pour les débutant·e·s et les novices dans le monde du community organizing. Lorsque les négociations liées à cette revendication ont commencé, nous avons rencontré un petit peu de résistance de la part du service de la voirie. Et c’était justement le moment, d’un point de vue organisationnel, de rassembler les membres de l’organisation autour d’un problème commun. Donc une brigade entière d’habitant·e·s (des gens qui n’avaient même pas terminé le lycée) a lu de vrais manuels d’ingénierie de la circulation pour s’assurer que nous ne commettions pas d’erreur. Puis nous avons convié l’ingénieur de la circulation à une grande réunion, mais il nous a répondu qu’il ne pouvait pas venir. Alors nous avons fait quelques recherches à son sujet, et nous avons découvert qu’il ne pouvait pas venir parce que ce soir-là, justement, il allait être intronisé en tant que grand maître de sa loge maçonnique. Alors on a rempli deux bus d’hommes et de femmes noir·e·s et de personnes venant des quartiers défavorisés de la ville, et nous avons fait une entrée fracassante. Et il était là, élégant et bardé d’insignes, et nous, nous avons juste traversé la pièce, on lui a tendu l’invitation en disant : « on s’est dit qu’on viendrait à vous, étant donné que vous ne pouviez pas venir à nous ». Le gars était sur le point d’exploser. Vous avez 500 personnes qui viennent des quartiers défavorisés, dont la vie quotidienne est vraiment rude et qui ont l’habitude d’être méprisé·e·s. Et là, pour la première fois, ils/ont l’opportunité d’embarrasser un gars riche, puissant et raffiné. Tu peux imaginer à quel point c’était jouissif !
Tu parles d’actions organisées dans des quartiers afro-américains. Mais je ne comprends pas qui était en charge de l’organisation. Y avait-il des organisateur-rice-s afro-américain-e-s ?
Oui. En 1972, l’organisation a intentionnellement recruté des organisateur·trice·s afro-américain·e·s. Mais un des problèmes, à l’époque, était que le travail d’organisateur·trice n’était pas bien payé. Personnellement, je vivais avec $50 par semaine, grâce aux allocations. Et à l’époque, ma femme travaillait aussi comme organisatrice, donc on n’avait vraiment pas grand-chose. Le directeur général de l’organisation pour laquelle je travaillais touchait un salaire. Mais nous autres, on parvenait à peine à subvenir à nos besoins. C’était un travail qu’on faisait par passion. Et, concrètement, seules des personnes blanches de classe moyenne pouvaient se permettre le luxe de vivre de cette manière pendant relativement longtemps.
Est-ce que vous essayiez de trouver de l’argent pour changer la situation ?
Oui, mais il y avait aussi un problème structurel. Il n’y avait pas beaucoup d’argent pour payer des organisateur·rice·s, et dans les endroits où on avait réussi à ouvrir des postes qui payaient bien, certaines personnes essayaient d’en profiter et de tirer leur épingle du jeu. Dans le quartier de Federal Hill, le quartier italo-américain dans lequel j’ai travaillé après mon premier job, tout le programme de lutte contre la pauvreté avait été noyauté par la mafia. Littéralement. Le président du conseil d’administration était âgé et, un beau jour, des hommes de main de la mafia l’ont fait passer par la fenêtre et l’ont suspendu par les jambes, jusqu’à ce qu’il accepte de les laisser gérer les salaires du programme de lutte contre la pauvreté. Quatre mois après le début de mon travail là-bas en tant que community organizer, un journal a titré : « Un community organizer de Federal Hill tué dans un affrontement entre gangs ». C’est parce que tous les soi-disant postes de community organizers étaient occupés par des voleur·se·s et des gangsters. Ce genre de corruption est lié à un autre problème qui émerge lorsque les organisateur·trice·s occupent des postes bien payés. Les gens commencent à demander « Mais attendez, comment se fait-il que les organisateur·trice·s soient payé·e·s alors que les bénévoles et les activistes font ça gratuitement ? ».
C’est une question que certain·e·s militant·e·s se posent actuellement en France. Pour ma part, j’essaie de défendre l’idée que la plupart des organisateur·trice·s devraient être rémunéré·e·s en tant que professionnel·le·s. Mais en même temps, je me rappelle d’une formation au Royaume-Uni où quelqu’un a demandé au community organizer de Citizens UK : « Quelle est la différence entre un·e leader·use et un·e community organizer ? » Et le gars a rigolé et a dit : « Oh, la différence, c’est que les organisateur·trice·s sont payé·e·s ».
Historiquement, ça c’est la réponse donnée au sein du réseau Alinsky. Mais je dirais que cette approche, bien que provocante, a tout de même de la valeur, parce qu’elle sous-entend qu’au sein de la community organization, tout le monde est responsable de la santé de l’organisation, de son futur, de ses rapports de pouvoir et de sa stratégie. Et dans ce contexte, le rôle spécifique de l’organisateur·trice est simplement de coordonner les efforts et de s’assurer que les actions mises en œuvre correspondent bien à ce sur quoi tout le monde s’est mis d’accord. Malgré tout, je trouve plus satisfaisante la réponse selon laquelle le travail de l’organisateur·trice consiste à aider une communauté à déterminer comment construire du pouvoir et comment le structurer au sein d’une organisation. Il s’agit d’une compétence. L’organisateur·trice a été formé·e·e, il/elle a de l’expérience et des connaissances, et son rôle est de se réveiller chaque matin et de ne penser qu’à ça. C’est sa responsabilité.
Alors que penses-tu des organisations qui payent leurs organisateur·trice·s au lance-pierre ?
Prenons l’exemple d’ACORN. Traditionnellement, ils/elles proposaient les pires salaires. Au bout d’un moment, ils/elles se sont rendu compte que tous/toutes leurs organisateur·trice·s étaient des blanc·he·s issu·e·s de la classe moyenne. Les membres d’ACORN ont alors soulevé ce problème, et les leader·euse·s de l’organisation se sont rendu compte qu’il s’agissait d’une faiblesse. Ils/elles ont essayé d’augmenter les salaires, et ils/elles ont essayé de recruter plus de personnes de couleur. Mais la tension persiste toujours. Et de l’autre côté du continuum, on a l’approche de l’IAF 8 qui consiste à dire : « nous voulons payer les organisateur·trice·s en tant que professionnel·le·s pour que tout le monde les estime sur la base du salaire que nous leur reversons. » Tu sais, quand on paie quelqu’un $10,000 par an, les attentes vis-à-vis d’elle/lui sont différentes que si on la/le paie $100,000 par an.
Ce sont deux points de vue extrêmement différents !
Oui, tout à fait. Dans certains courants de l’organizing, les organisateur·trice·s sont peu payé·e·s pour que personne ne se batte pour le poste ou ne pose trop de questions. Et dans d’autres courants, c’est l’exact inverse : les organisateur·trice·s sont bien payé·e·s et se mettent sur leur trente-et-un pour travailler, parce que pour eux c’est ce que font les professionnel·le·s.
Je me rappelle qu’à Citizens UK, les organisateur·trice·s portaient un costume ou un tailleur où qu’ils/elles aillent. C’était souvent déplacé et un peu bizarre.
C’est comme les moines franciscains. Quand ils ont commencé à se promener en sandales et en robe de bure avec une corde en guise de ceinture, les gens disaient : « Ah, vous êtes pauvres, donc c’est normal ». Et maintenant, ce genre de vêtement semble complètement exotique. Le temps a passé et la signification première de cette tenue a été perdue.
Pour revenir un peu à ton parcours : comment est-ce que tu as pu devenir directeur général d’une community organization après seulement un an d’expérience ?
Dans la community organization pour laquelle je travaillais, il y avait une tradition d’apprentissage par le terrain : on suivait partout un·e organisateur·trice confirmé·e, avec en tête l’idée de passer un an à apprendre, puis on partait travailler en tant que directeur·trice d’une toute nouvelle community organization dans un autre quartier de la ville. C’était le cycle des choses. Et donc, après un an, je suis devenu directeur général d’une toute nouvelle organisation ailleurs dans la même ville. Mais c’était dans un quartier qui ne faisait pas partie de notre réseau, et j’ai donc travaillé tout seul pendant deux ans. Puis, avec ces trois ans d’expériences comme organizer, j’ai créé centre de formation pour community organizers sur toute la Nouvelle Angleterre. Je faisais régulièrement le tour des community organizations locales, pour proposer des ateliers sur le leadership, les levées de fond et de façon générale toutes les façons dont les membres de ces organisations pouvaient développer leur pouvoir collectif. Par ailleurs, notre réseau local faisait partie d’un réseau plus large, le People’s Action Network,9 et je jouais en quelque sorte le rôle d’intermédiaire entre le réseau national et nos community organizations locales. A ce poste, j’avais une vision plus globale sur le travail d’organisation, avec un regard tant sur la création de nouvelles community organizations que sur le soutien aux organisations déjà existantes.
Est-ce que tu as travaillé longtemps dans ce centre de formation ?
Pas si longtemps que ça. Ma femme a obtenu son diplôme universitaire, et nous avons décidé de faire une petite pause. J’ai quitté mon poste au centre de formation et je suis allé travailler à Washington, pour la Legal Services Corporation, qui est une ONG nationale qui fournit une assistance juridique aux plus défavorisé·e·s.

Tu as un diplôme de droit ?
Bien sûr que non ! Je n’ai aucun diplôme universitaire. Mais un bon ami, dont le travail consistait à former des avocat·e·s, a un jour décidé de recruter plusieurs organisateur·trice·s pour former les avocat·e·s à travailler avec les community organizations. C’est comme ça que je me suis retrouvé à travailler pour une ONG pendant trois ans. Mon travail consistait donc à former des avocat·e·s et des expert·e·s du droit, mais aussi à distribuer des financements à des programmes d’assistance juridique locaux, ce qui m’a aussi permis de financer indirectement de nombreuses organisations militantes de terrain. Je suis même fier de dire que dans chaque livre qui attaque Hillary Clinton, il y a un chapitre sur ce qu’on a fait à l’époque pour la Legal Services Corporation, parce qu’elle faisait partie du comité. Tout ce qu’on a fait à ce moment-là est aujourd’hui perçu comme exemplifiant sa vision maléfique et socialiste des choses. Mais en réalité, Hillary n’avait pas la moindre idée de ce qu’on faisait, parce qu’on cachait la plupart notre travail à ceux/celles qui nous avaient recruté·e·s. On s’amusait bien !
Est-ce que tout cela n’était pas très éloigné du community organizing ?
Traditionnellement, les avocat·e·s qui s’engagent auprès des plus démuni·e·s ont tendance à se percevoir comme des chevalier·e·s blanc·he·s. Ils/elles trouvent une cause à défendre pour se donner un but. Et ils/elles cherchent quelques client·e·s dont ils/elles peuvent citer les noms, pour ensuite foncer tête baissée dans la bataille. Or, avec notre petit groupe d’organisateur·trice·s, nous avons contribué à redéfinir cette perspective en disant que changer les lois ou gagner des procès, c’est très bien, mais que ce n’est pas un but en soi. Dans un combat juridique qui veut vraiment respecter le processus d’auto-organisation des plus démuni·e·s, le client c’est la community organization ; et l’objectif premier, c’est le pouvoir collectif des gens. On a réussi à défendre cette idée là pendant trois ans. Et puis j’ai commencé à rechercher du travail en-dehors de Washington lorsque j’ai assisté à l’inauguration de Ronald Reagan à travers la fenêtre de mon bureau. A l’époque, je voulais tenter une expérience : voir si une organisation de quartier pouvait avoir un impact sur des questions économiques. Je voulais vraiment retourner au community organizing de terrain.
Est-ce que c’est à ce moment-là que tu es arrivé à Toledo ?
Oui. J’avais travaillé en tant que formateur là-bas, je connaissais les organisateur·trice·s sur place et je savais qu’ils/elles cherchaient un·e nouveau·elle directeur·trice. Je suis donc devenu le directeur de la community organization de l’est de Toledo. Là encore, sur le papier il s’agissait d’une « organisation d’organisations », mais en réalité, c’était une grassroots organization. On mettait le bazar et on s’éclatait. C’était un quartier industriel qui était passé par une très mauvaise période. Notre slogan était : « refaisons fumer les cheminées d’usine ! ». Nous avons choisi d’orienter notre travail autour du développement économique du quartier. Nous avons fait des tas de choses créatives : un plan d’urbanisme co-écrit avec les habitant·e·s, une Zone de Développement Industriel et tout un travail autour de la politique fiscale. Nous nous sommes également beaucoup investi·e·s dans un projet d’élargissement d’une route qui a) augmentait la viabilité économique des sites concernés et b) permettait d’éviter que le trafic lié à l’industrie passe par les quartiers résidentiels. On a vraiment mis le bazar pour décrocher cet accord ! Les gros titres du journal local indiquaient que « l’Est de Toledo est trop vicieux pour mourir ».
Tu as ensuite fait toute ta carrière comme organizer ?
Non, pas du tout. A un moment donné, j’ai abandonné mon rôle de directeur général de la community organization pour y devenir responsable du développement économique. Et après ça, j’ai commencé à travailler à mi-temps dans une université d’urbanisme pour y promouvoir l’organizing et les démarches de planification centrées sur les habitant·e·s et le développement des community organizations. Le reste du temps, je travaillais pour le Center for Community Change, une organisation nationale, et je soutenais les efforts d’organisation dans tout le pays. Après quelques années à travailler comme ça, j’ai commencé à travailler pour le Center for Community Change à temps plein. J’ai fait ça pendant 15 ans. Et après ça, une fondation nommée le fonds NeedMor, qui finance le community organizing et qui est située à Toledo, m’a demandé de devenir leur directeur général. Et là, je suis passé de l’autre côté des demandes de financement. Pendant 10 ans, nous avons donné de l’argent à des personnes qui faisaient du bon travail en tant que community organizers. Et après ça, j’ai officiellement pris ma retraite. Parfois, je me dis que je n’ai pas eu d’emploi honnête depuis l’usine de fabrication de rideaux !
L'Université Populaire des Luttes
Traduire, rechercher, mettre en page et faire vivre notre communauté de bénévoles permet de garder en mémoire les récits de luttes, sources inépuisables d’espoirs et d’inspirations tactiques et stratégiques.
Dans un système politique prédateur dont l’un des objectifs est de nous priver de nos repères militants historiques, les moyens de financer ce travail de mémoire sont rares.
Pour nous aider à garder cette université populaire des luttes accessible gratuitement et contribuer à renforcer nos luttes et nos solidarités, faites un don !
Pour aller plus loin
Le Guide du Routard de l’Organizing de Dave Beckwith fait l’objet de plusieurs ressources sur Organisez-vous !

Texte intégral
![]()