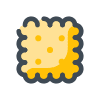Derrière l’expression «community organizing» se cache une pratique politique très ancienne.
Au début du XXème siècle, “s’organiser” signifiait avant tout se réunir, s’allier, s’équiper et monter en puissance avant de se lancer dans la lutte.
Mais avec le temps (et l’oubli progressif des méthodes d’organisation collective), c’est tout un vocabulaire militant qui a été récupéré et/ou oublié, jusqu’à ce que même l’expression “s’organiser” perde son sens politique.
Le premier pas vers un changement de stratégie militante, c’est donc de se réapproprier le vocabulaire de l’organisation collective. C’est pourquoi nous vous proposons ici un petit abécédaire, qui a pour vocation de recenser et de définir, de façon claire et précise , tous les concepts-clés qui font la force du community organizing.